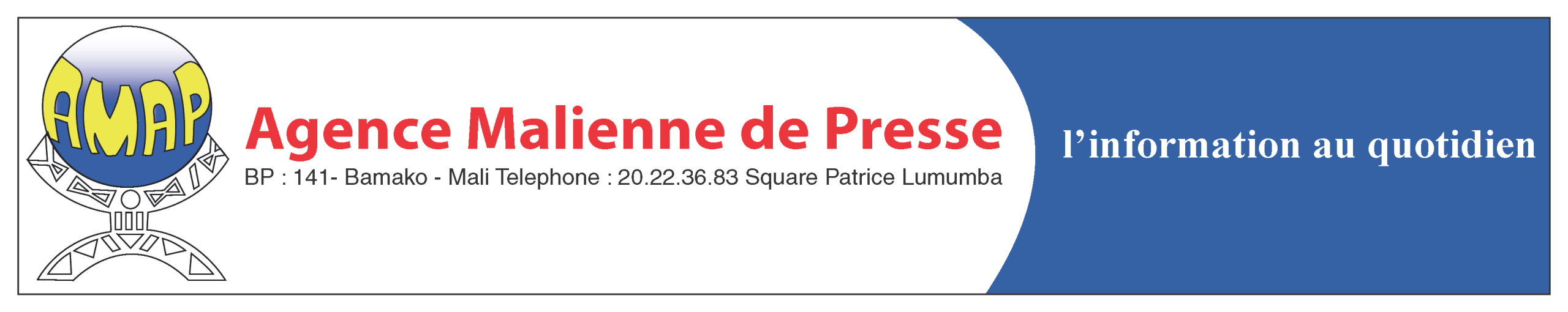En temps de crise, le traitement de l’information implique davantage de responsabilité de la part des journalistes
Par Souleymane SIDIBE
La communication est une arme redoutable que les protagonistes des conflits utilisent à profusion. Chacun manipule, travestit, tronque, dissimule les faits. Ala vois pour obtenir l’adhésion de l’opinion publique et pour nuire à l’ennemi. D’où l’adage : « Lorsque la guerre éclate, la vérité est la première victime ».
Le Mali est depuis plus d’une dizaine années confronté à une guerre double : un conflit armé dévastateur imposé par des Groupes armés terroristes et leurs supposés soutiens occultes, et un «terrorisme médiatique» perceptible à travers les contenus «tendancieux» visant à ternir l’image du pays et saper en même temps le moral de la troupe.
Tout comme le contrôle des positions stratégiques, le contrôle de l’information en temps de guerre est également un enjeu vital pour espérer remporter des victoires contre l’ennemi et consolider la confiance entre les hommes en treillis et la population. Les campagnes d’intoxication et de désinformation opérée par les médias prouvent à suffisance que l’information et la communication en temps de guerre constituent une arme redoutable que les protagonistes de la crise utilisent abondamment à leur avantage.
Pendant la crise, la désinformation et la propagande sont utilisées à profusion. La désinformation, selon les spécialistes, utilise des techniques qui permettent de travestir une information fausse en une information apparemment crédible et qui oriente l’action de celui qui la reçoit dans un sens qui lui est défavorable. Elle se traduit par la fabrication de faux documents, la falsification de données existantes, etc.
Quant à la propagande, elle consiste à produire des argumentaires selon des techniques bien précises pour obtenir l’adhésion de l’opinion publique à vos thèses. Il s’agit donc de manipuler l’opinion pour lui faire accepter les points de vue du propagandiste. Prenons l’exemple d’une super puissance qui occupe le territoire d’un pays pauvre afin de jouir des richesses minières ou énergétiques, ou encore, de contrôler une zone stratégique. D’abord, il justifiera sa présence dans ce pays en donnant des raisons nobles, comme le respect et l’instauration de la démocratie, la protection des minorités, la lutte contre le terrorisme.
DIABOLISER L’ENNEMI – Ce type de manipulation se fait très généralement à l’aide de médias qui font des productions visant à faire accepter les décisions, les choix et les stratégies de la puissance qui entend imposer son influence. La désinformation et la propagande en période de crise se caractérisent donc par le fait de toujours blanchir les intérêts sordides d’une campagne pour leur donner une noble apparence.
Les puissances coloniales ont longtemps utilisé ces techniques dans certaines régions du monde pour diviser et dresser les peuples les uns contre les autres. Cela se caractérise par la diabolisation d’un camp en le présentant comme un véritable danger. Ainsi, ils arrivaient à prendre le contrôle de tel pays ou de telle région.
Les mêmes techniques sont utilisées aujourd’hui pour obtenir le consentement de l’opinion ou de la dresser contre l’ennemi. Journaliste et chargé de mission à la Haute autorité de la communication (Hac), Hamèye Mahamadou Maïga explique : «C’est une période pendant laquelle les acteurs essayent, chacun de leur côté, de manipuler l’information. Ils essayent de falsifier et d’interpréter de manière inexacte l’information toujours pour désorienter l’opinion publique. Ils font cela pour qu’on puisse dire que ce sont eux qui détiennent la vérité et que la situation est en leur faveur ».Après avoir rappelé l’adage qui dit que « lorsque la guerre éclate, la première victime, c’est la vérité », Souleymane Drabo, journaliste et ancien directeur général de l’Agence malienne de presse et de publicité (Amap), rappelle que toutes les guerres modernes se remportent à la fois sur le terrain militaire et sur le plan de la communication. Pour lui, la guerre Russie-Ukraine illustre parfaitement cette réalité.
« La Russie a l’avantage militaire sur l’Ukraine. Elle a bombardé et conquis une partie du territoire ukrainien, mais sur le plan de la communication, la balance penche indiscutablement du côté des Ukrainiens », explique Souleymane Drabo. Et d’ajouter : «Non seulement les Ukrainiens ont un président qui est lui-même un communicateur, mais ils ont aussi une communication rationnelle, organisée, méthodique et intelligente. En temps de crise, la communication se transforme donc en arme, les demi-vérités, contrevérités et mensonges prospèrent ».
RESPONSABILITÉ – Dans une telle situation, quelle doit être le comportement du journaliste ? Comment prévenir les dérives et protéger le droit du citoyen à l’information ? L’ancien ministre de la Communication, Gaoussou Drabo, répond : « les réflexes qu’on a en temps normal, sont mis en pratique en période de crise mais de manière exponentielle parce que la crise crée des tensions. Elle fait perdre le sens de la mesure. Elle ne vous permet pas cette lucidité nécessaire à faire un jugement avisé ». Pour lui, la crise révèle une excroissance de l’attitude professionnelle en temps normal. « Si vous êtes posé et serein en temps normal, vous développerez les mêmes reflexes en temps de crise », soutient-il.
En temps de crise, le traitement de l’information implique davantage de responsabilité de la part du journaliste et vis-à-vis du public au profit duquel il collecte, traite et diffuse l’information. À cet égard, il importe de mettre en garde contre les dérapages susceptibles d’aggraver la situation, estime le sociologue Dr Fodié Tandjigora. « Si l’État ne protège pas l’information, s’il ne dicte pas la marche à suivre, cela risque de provoquer des dérives », souligne le chercheur, faisant allusion à la diffusion des informations susceptibles de « saper le moral des troupes au front et de discréditer l’État ».
Beaucoup de dérives ne sont pas le fait des journalistes, relève le directeur de publication du bihebdomadaire Mali-Tribune Alexis Kalambry. «Malheureusement, avec les réseaux sociaux, tout détenteur de téléphone, de smartphone, est devenu un vecteur d’information. Ce qui ne devrait pas être le cas», regrette le patron de presse. Abondant dans le même sens, Gaoussou Drabo fait remarquer aussi que sur internet, n’importe qui s’improvise journaliste. «Mais quand on est formé dans une école de journalisme, on apprend l’éthique et la déontologie qu’on respecte. Il y a un code d’éthique mais il y a aussi le code de la presse. Il y a une morale qu’on a en tant que journaliste parce qu’on a choisi ce métier pour ses valeurs, pour ses restrictions sur soi à savoir la vérification de l’information», rappelle l’ancien ministre de la communication.
EFFETS PERVERS – Pour minimiser les dérives, le vice-doyen de la FSAP propose d’intensifier les activités de sensibilisation et la surveillance des réseaux sociaux dans le respect strict du droit. « Cela suppose un accompagnement de l’État sur la problématique de la sanction par les pairs qui a beaucoup plus d’impact psychologique sur les acteurs que le tout répressif », suggère le Pr Abdoul Sogodogo.
La meilleure façon d’encadrer la presse est de mettre en place des textes consensuels et connus de tout le monde, renchérit le directeur de Mali-Tribune. Se disant favorable à un dispositif d’encadrement permettant l’exercice libre et correct, Alexis Kalambry préconise de mettre en place un environnement sain et de veiller à la formation des journalistes. à ce propos, il attire l’attention sur l’importance de l’aide à la presse que l’état a tendance à négliger ces dernières années.
Le Pr Abdoul Sogodogo propose d’impliquer les journalistes dans l’encadrement afin qu’ils puissent appréhender par eux-mêmes les conséquences des effets pervers de la diffusion de la fausse information. «Par exemple, la dépénalisation des délits de presse s’inscrit dans cette logique. Dans cette dynamique, aucun journaliste ne va en prison pour avoir fait son travail. Ainsi, d’autres sanctions sont mises en avant», détaille-t-il, affirmant que tout encadrement juridique est une restriction de libertés ou du droit à l’information. Le professeur rappelle l’existence des lois sur la cybercriminalité qui encadrent les dérives sur les réseaux sociaux. Il demande également à l’État d’écarter ceux qui ne possèdent pas la carte de presse.
SS (AMAP)