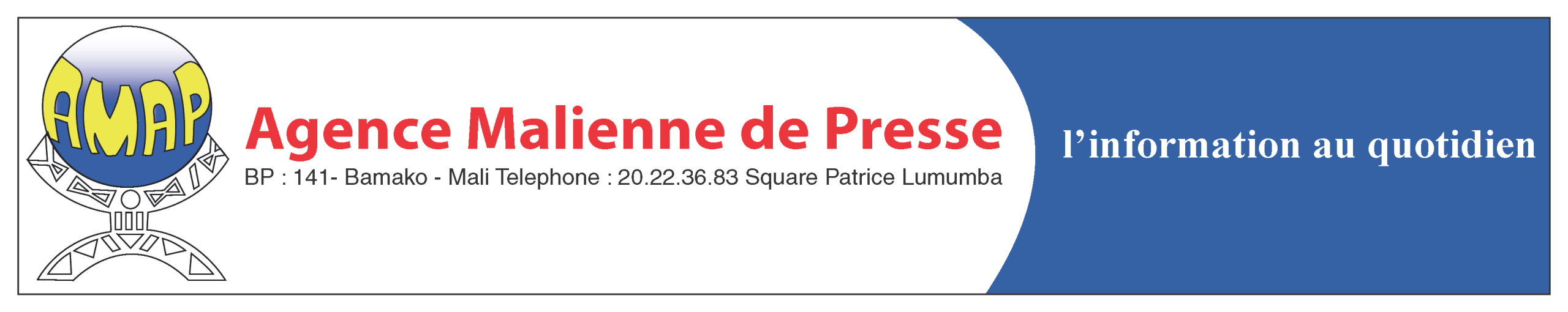Par Amadou SOW
 Ce grand essor des tissus traditionnels maliens est perçu comme un symbole de fierté nationale et une expression de patriotisme. Mais surtout de soutien à la volonté de s’extraire du joug de la domination extérieure
Ce grand essor des tissus traditionnels maliens est perçu comme un symbole de fierté nationale et une expression de patriotisme. Mais surtout de soutien à la volonté de s’extraire du joug de la domination extérieure
L’affirmation de notre identité passe-t-elle aussi par le textile malien ? Beaucoup répondent par l’affirmative au regard des actions de promotion de nos tissus traditionnels par les autorités de la Transition. Ainsi, celles-ci ont fait du développement du coton local, leur cheval de bataille. La valorisation des habits à base de cotonnade est un grand pas dans ce sens. Le processus remonte aux premières heures de l’indépendance de notre pays. Bien que l’état a réussi des actions comme la création d’usines, de centres de formation, l’organisation des foires et l’adoption de textes relatifs à la promotion et la vulgarisation du textile malien, le chemin à parcourir pour imposer le made in Mali à une plus grande échelle reste long et plein d’embûches.
Le «Mali Kura» doit se nourrir d’une gouvernance vertueuse, de la volonté de retourner à certains fondamentaux. Il doit aussi reposer sur la mise en valeur de nos tissus «Malifiniw». C’est dans cette vision que les nouvelles autorités ont entrepris de mettre en exergue le label malien. Un accent particulier a été mis sur la production locale afin d’imposer la marque du pays.
PLUS DE 42% DE LA POPULATION – Le directeur général du Centre de développement de l’artisanat textile (CDAT), Ousmane Coulibaly, rappelle les efforts de relance du textile à travers le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. Et l’adoption par le gouvernement de la Politique nationale de l’artisanat qui intègre le textile.
Notre interlocuteur évoque aussi les mécanismes de production et de consommation du textile malien, l’organisation de la 3è édition du Salon international de l’artisanat du Mali (Siama) qui traduit la volonté du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, de répondre à l’aspiration profonde de faire de l’artisanat un moteur de croissance, de développement, de création d’emplois et de richesses. Ce secteur occupe plus de 42% de la population et contribue significativement au Produit intérieur brut (PIB) du pays.
Ousmane Coulibaly parle également des initiatives privées comme les Journées textiles du Mali à l’initiative de l’Alliance des journalistes pour le développement de la culture (AJDE). Le développement de la filière coton qui a servi de stimulant à la relance des usines et unités de fabrique de tissus, l’appui institutionnel aux faitières, la création de la route du textile (Bamako-Ségou-Markala), de plateformes promotionnelles du textile, entre autres, sont à mettre à l’actif des autorités.
L’Etat a aussi relancé la Compagnie malienne de Textile (COMATEX) en injectant une première tranche de plus de 600 millions de Fcfa. Il y a eu aussi l’organisation d’un atelier national intitulé : «Vision concertée dans le secteur de l’industrie textile», la formation des acteurs de la chaine, l’augmentation de la production à travers la validation d’un programme quinquennal du CDAT.
Toutes ces actions ont permis à notre pays de retrouver son leadership dans la production du coton. Environ 2% seulement sont transformés. D’où la nécessité d’œuvrer à la promotion du made in Mali. Cela implique la disponibilité de ressources humaines qualifiées, la revitalisation des structures de formation comme le Centre de recherche et de formation pour l’industrie textile (Cerfitex) de Ségou.
ADHÉSION – «Oui, le textile malien a connu un grand essor pendant la Transition», constate le promoteur de Biotex, Moussa Bagayoko. Le sexagénaire rappelle que jadis, un tissu traditionnel à base de cotonnade était offert au marié par sa belle-mère qui confectionnait elle-même la matière première (le fil). Avec ce tissu, le beau-fils devait coudre un grand boubou.
Aujourd’hui la population adhère à la valorisation du textile malien. Tisserands, revendeurs, tailleurs et autres acteurs des métiers connexes se frottent les mains. Ce boom du made in Mali est perçu comme un symbole de fierté nationale et une expression de patriotisme et de soutien à la volonté de s’extraire du joug de la domination étrangère.
Premier ministre, membres du gouvernement et présidents des institutions s’habillent fièrement de tissus maliens. On se souvient du passage du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga à la tribune des Nations unies en septembre 2021, vêtu de son grand boubou en tissu de cotonnade. Aussi des millions de Fcfa ont été injectés dans des projets de relance d’usines de fabrique de tissus ou de fils. Le gouvernement et ses partenaires entendent convenablement approvisionner le marché en matière première. Un projet de labélisation du textile malien est actuellement en cours en vue de permettre à nos compatriotes de consommer malien.
Aïchatou Dembélé, styliste et promotrice de Farafina Design, souligne les difficultés à accéder aux matières premières : «l’accès aux matières premières est toujours difficile alors que la demande augmente».
Oumarou Tamboura, tisserand à Daoudabougou, confie que sa profession reprend des couleurs. Elle se réjouit du fait que l’accompagnement du ministère en charge de l’Artisanat y est pour quelque chose.
Précisons que le CADT a été créé en 2012 grâce au projet Tissuthèque initié par le gouvernement et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel, avec l’appui financier du Japon. La structure a pour mission la transformation artisanale des textiles produits localement.
AS (AMAP)