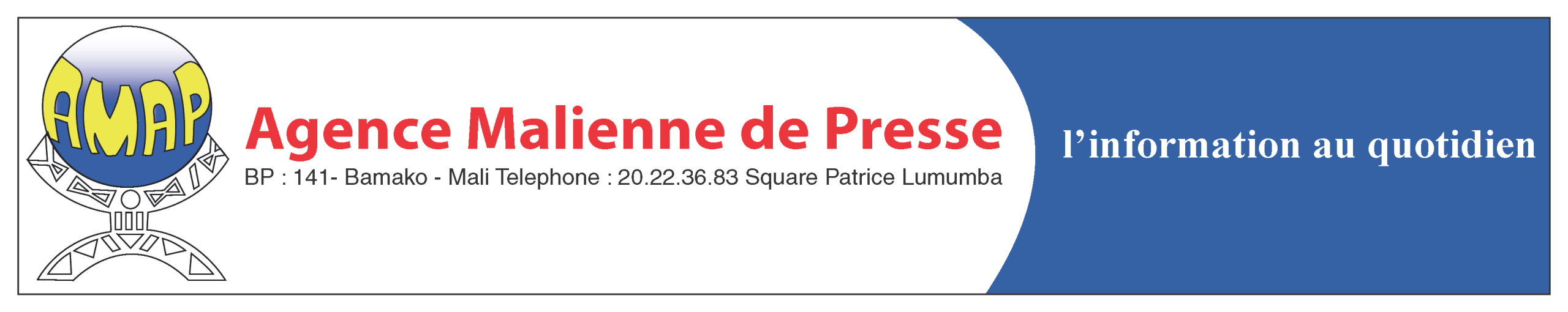Mise en place de la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution, le 12 juillet 2022 au palais de Koulouba
Par Issa DEMBELE
Nouvelle Constitution, nouvelle loi électorale, relecture de la charge des partis politiques, réorganisation territoriale, tout est mis en œuvre pour l’avènement d’un Mali nouveau, afin de combler l’espoir de nos compatriotes
Neuf mois après la tenue des Assises nationales de la refondation (ANR), une chose est perceptible : l’amorce des reformes politiques et institutionnelle. Les autorités de la Transition répondent ainsi à une demande forte des Maliens qui conviennent de la nécessité de rénover le cadre politique et réadapter les textes fondamentaux, dont l’usage a fait apparaître des insuffisances. Nombreuses sont en effet les exigences suscitées par la marche du temps et les péripéties sociopolitiques. L’étendue du besoin de reformer est tel que dès l’abord, les autorités ont estimé qu’elles devaient s’en tenir aux reformes «indispensables». Il s’agit de l’élaboration d’une «nouvelle Constitution» et d’une «nouvelle loi électorale», la relecture des «textes connexes à la Constitution et à la loi électorale» et la «réorganisation territoriale».
La loi n° 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale constitue la «colonne vertébrale» de cet ensemble de reformes devant permettre à notre pays de repartir sur de bonnes bases. Sa promulgation par le président de la Transition a marqué le début de la matérialisation de ces chantiers dont les durées d’exécution sont indiquées dans un chronogramme consensuel. Tout le processus se veut inclusif, afin d’en finir avec la hantise des crises politiques. Les acteurs politiques et sociaux sont au rang des interlocuteurs privilégiés dans cette recherche du consensus.
INSTITUTIONS SOLIDES – Ainsi, la nouvelle loi électorale se met en œuvre dans une démarche consensuelle. L’on s’attèle, concomitamment, à l’élaboration de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, pour laquelle une Commission de rédaction a été mise en place par décret présidentiel n°2022-0342/PT-RM du 10 juin 2022 pour une durée de deux mois. L’équipe doit mettre en adéquation la norme suprême et les exigences de la réalité. Il le faut au regard des lacunes révélées, au prisme de la pratique démocratique, par la Constitution de 25 février 1992. La fragilité des institutions de la 3è République n’est plus à démontrer.
La nouvelle loi fondamentale, dont l’avant-projet devait être remis au chef de l’Etat le 12 septembre dernier, est donc censée apporter une certaine solidité à nos Institutions. Et dans cette optique, les préconisations faites par les forces vives sont multiples. Elles ont été recensées par la Commission de rédaction, conformément aux instructions du président de la Transition. L’étape des écoutes a été bouclée le 8 août dernier.
Reste que l’idée d’aller vers une nouvelle Constitution ne fait toujours pas l’unanimité. Me Cheick Oumar Konaré, qui est de ceux-là qui trouvent nécessaire la reforme, soutenait, dans un débat télévisé en juin, que l’un des éléments à intégrer dans la Constitution est la régionalisation. La question du mandat des élus devrait également y trouver une place, car «l’origine de l’échec de notre processus démocratique est due au fait que le peuple est dépouillé de ses pouvoirs au profit des représentants élus et du fait que ces représentants n’ont même pas l’obligation de rendre compte…».
De son côté, Me Baber Gano, secrétaire général du RPM, plaidait, lors d’une réunion du Cadre de concertation, une révision à minima. Comme le RPM, les partis Adema-Pasj, Yelema ou encore la Cenas-Faso Hère estiment que des dispositions de l’actuelle loi fondamentale peuvent être améliorées, corrigées ou amendées sans remettre en cause sa substance. Il reviendra aux Maliens de trancher, à la faveur du scrutin référendaire annoncé pour le 19 mars 2023.
TEXTES CONNEXES – Le gouvernement engagera alors, à partir de juin 2023, la relecture de quatre textes connexes à la Constitution et à la loi électorale. Les deux premiers sont relatifs au Comité national de l’Egal accès aux médias d’Etat (loi n°93-001 du 6 janvier 1993) et à la Cour constitutionnelle (loi n°97-010 du 11 février 1997). Le troisième texte (loi n°02-010 du 5 mars 2002) concerne les membres de l’Assemblée nationale et le troisième est la loi n°05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques.
La charte retient beaucoup plus les attentions, puisqu’elle définit les règles relatives à la formation, à l’organisation et au financement des partis. Nombre de Maliens sont d’avis qu’il faut arrêter la déliquescence de nos formations politiques qui se conçoivent surtout comme des instruments au service de la promotion personnelle de leurs leaders. La relecture de la charte et des autres textes permettra d’intégrer les «outils et les dispositions qui renforcent les partis politiques, la présence des femmes en leur sein», expliquait en mai dernier Mme Sylla Fatoumata Dicko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Reformes politiques et institutionnelle.
Le dernier chantier majeur, est celui de la réorganisation territoriale. Déjà en cours, elle vise uniquement à opérationnaliser les régions et le District de Bamako créés par la loi n°2012-017 du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en République du Mali. En conséquence, elle ne «comportera aucune nouvelle création de Région ou de District», précise le département en charge de l’Administration territoriale. Elle ne saurait non plus « comporter de création de nouvelles communes sauf cas d’impérieuses nécessités». Le pays comptera alors 1 District, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements et 807 communes. L’avantage, c’est que l’administration sera plus proche des populations. Celles-ci accéderont alors facilement aux services sociaux de base.
En plus de ces réformes, plusieurs stratégies nationales sont élaborées dans le cadre de la refondation. On peut citer la stratégie nationale garantissant la dépolitisation de l’administration. Cela est une nécessité, car aujourd’hui, les nominations, les affectations et les recrutements sont très souvent des outils de rétribution pour les partis à leurs «électeurs» au détriment des cadres valables.
ID (AMAP)