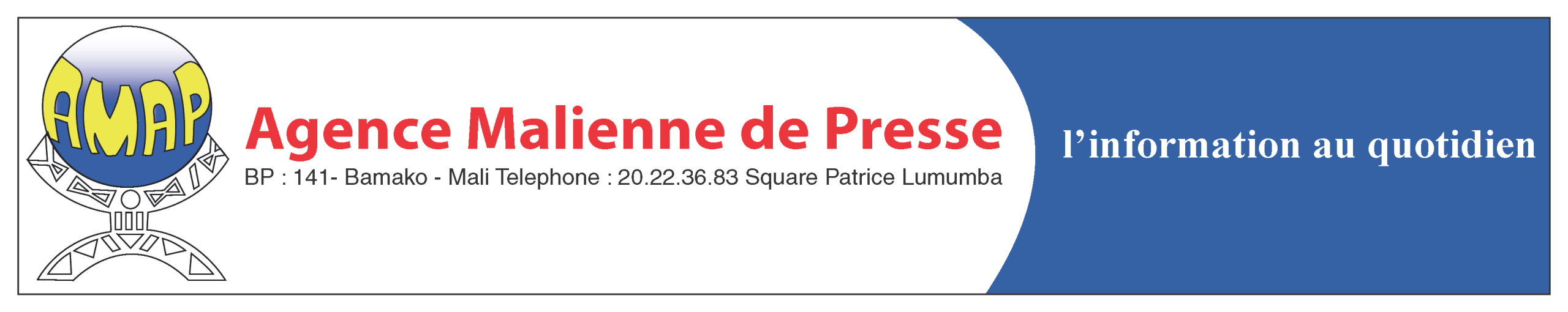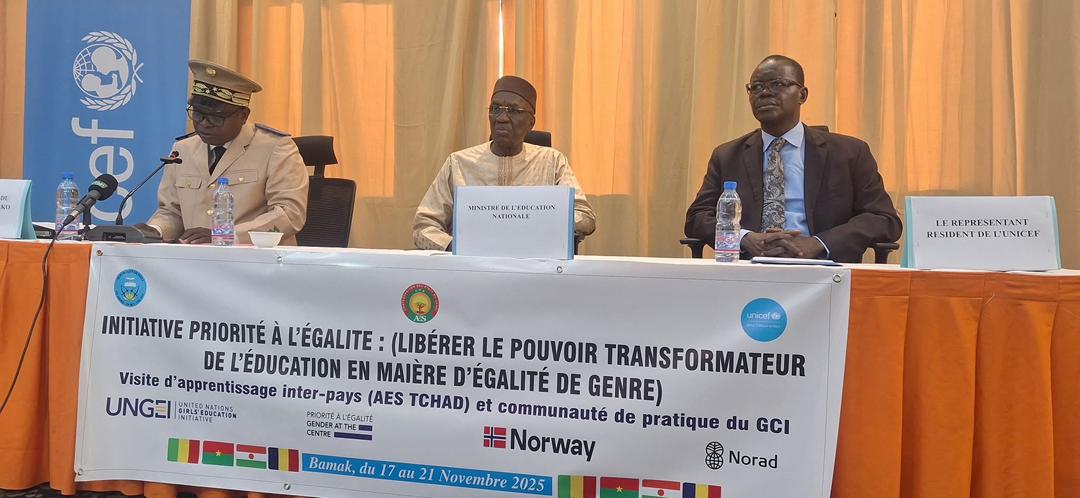Envoyé spécial
Envoyé spécial
Mohamed TOURE
Gao, 24 sept (AMAP) Certains lui ont déjà trouvé le surnom de « Ville bleue » à cause des nombreuses tentes en bâches de couleur ciel qui la rendent visible de loin. En plein désert, la Commune rurale d’In-Tillit est nichée au milieu de nulle part. La localité, située à 90 km de la ville Gao, dans le Nord du Mali, était presque dans l’anonymat total, il y a moins d’un an. Mais, avec la récente découverte de son potentiel aurifère, elle attise la convoitise de milliers de candidats à l’orpaillage qui y ont créé leur nouvelle ville.
Chaque jour, d’interminables convois de jeunes quittent la ville de Gao pour le site d’orpaillage d’In-Tillit. Les véhicules les plus adaptés pour ce trajet sont les pick-up, à cause de l’état de la route et des capacités en passagers de ces voitures. Elles débordent de voyageurs dont les plus courageux n’hésitent pas à s’installer sur le toit du véhicule. Au risque d’être éjecté, en cours de route, à la suite d’une brusque accélération dont sont coutumiers les conducteurs. Sur les pistes buissonneuses et semi-désertiques, il n’y a pas de panneaux de signalisation. «Chaque pick-up peut prendre au moins une vingtaine de personnes en plus de leurs bagages. Le coût du transport est de 5.000 Fcfa par personne. Donc, nous pouvons gagner entre 90.000 et 100.000 Fcfa par voyage», confie Ag Mossa, un conducteur de pick-up, la moitié du visage caché derrière un turban.
Ils sont nombreux, les transporteurs, comme lui, à tirer leur épingle du jeu, à travers cette nouvelle activité. Une véritable économie s’est créée autour du business de l’orpaillage. Le métal précieux brille pour beaucoup de personnes dans la chaîne de cette économie.
Pour comprendre quelques paramètres du système, nous empruntons le chemin du site. Les groupes armés font partie des principaux acteurs de cette mini-industrie. Sur la route, entre Gao et In-Tillit, les check points anarchiques de ces derniers sont légion. Il n’est pas rare de voir des groupes d’hommes, qui, souvent, ne sont même pas armés, demander aux conducteurs de véhicules de payer entre 2.000 et 2.500 Fcfa.
A la sortie de Gao, nous dépassons un groupe de jeunes nigériens en partance pour In-Tillit. Une dizaine, baluchons sur la tête, ils sont décidés à faire le trajet de 90 km séparant Gao du site d’orpaillage à pieds. « Faute de pouvoir payer le transport », se justifient-ils.
MAITRES DES LIEUX – L’entrée du site est sécurisée par un groupe de jeunes, armes aux poings. Presque camouflés, ils sont installés sous un arbre. Après le contrôle des pièces d’identité, la règle est simple : payer 2.000 Fcfa, pour les Maliens et 5.000 Fcfa pour les étrangers. C’est le prix du ticket d’entrée et de séjour délivré par une commission mixte, formée par des éléments de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), ex-rébellion touarèque et de la Plateforme. La même opération est de rigueur pour sortir du site.
aux poings. Presque camouflés, ils sont installés sous un arbre. Après le contrôle des pièces d’identité, la règle est simple : payer 2.000 Fcfa, pour les Maliens et 5.000 Fcfa pour les étrangers. C’est le prix du ticket d’entrée et de séjour délivré par une commission mixte, formée par des éléments de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), ex-rébellion touarèque et de la Plateforme. La même opération est de rigueur pour sortir du site.
Une fois dépassé ce comité d’accueil, on aperçoit enfin le site. A première vue, elle donne l’impression d’une nouvelle ville bâtie autour de l’exploitation de l’or. Le nombre de personnes sur le lieu saute directement à l’œil. «Impossible de déterminer le nombre d’ouvriers sur le site. Mais, je pense qu’il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent ici, dont la grande majorité ne sont pas des Maliens», explique Ibrahim, un orpailleur malien rencontré sur le site. La quarantaine révolue, cet ancien expatrié en Europe, dit faire partir des tous premiers à avoir débarqué à In-Tillit, aux premiers mois de la ruée vers l’or sur le site.
Dans la multitude de nationalités présentes sur le site, les plus nombreux sont les Nigériens, les Burkinabè, les Tchadiens et les Soudanais. Plusieurs activités animent l’économie de cette petite bourgade. Si les étrangers sont plus nombreux dans l’exploitation des mines, beaucoup de jeunes viennent de Gao pour faire du commerce. «La ville bleue» dispose même d’un quartier des affaires, dénommé «Sardjila», où se mène le business. «Tout s’achète ici, à condition d’y mettre le prix», lâche un boucher, installé dans ce quartier et occupé à charcuter un gigot.
Les commerces sont multiples au «Sardjila», de la restauration à la vente de médicaments. Un peu plus loin après la boucherie, on peut apercevoir un salon de coiffure à côté d’un cabinet de guérisseur traditionnel. «Bienvenue chez nous. Vous connaissez la particularité de cette ville? Ici quand on n’a pas d’argent, on ne mange pas !», prévient notre ami boucher, avec un trait d’humour. De derrière sa table, il s’empresse d’argumenter, en expliquant que les prix normaux des produits sont systématiquement doublés sur le site. «Le sac de charbon coûte 10.000 Fcfa, la plaquette de paracétamol 300F cfa, le kilo de viande 5.000 Fcfa…», énumère-t-il. La spéculation n’épargne même pas l’eau, dont le bidon de 25 litres se négocie entre 750 Fcfa et 1.000 Fcfa. Le liquide précieux est transporté par citernes, depuis Gao.
 L’autre singularité de ce site d’orpaillage est, certainement, qu’il n’y aucun visage de femmes perceptibles à la ronde. A la question : où sont les femmes ? « Elles ne se sont pas tolérées par les groupes armés », répond-t-on. A la grande détresse de certains jeunes orpailleurs qui ne seraient pas contre un peu de compagnie féminine. «Il n’y a pas de femmes ici. Au début certaines ont essayé de venir, mais les groupes armés les ont sommées de partir et de ne plus revenir», relate un jeune vendeur de boissons. Le respect de la discipline est strict. «Ici, même la vente d’alcool est strictement prohibée. Celui qui se ferait prendre à mener cette activité aurait de sérieux soucis», poursuit le même vendeur.
L’autre singularité de ce site d’orpaillage est, certainement, qu’il n’y aucun visage de femmes perceptibles à la ronde. A la question : où sont les femmes ? « Elles ne se sont pas tolérées par les groupes armés », répond-t-on. A la grande détresse de certains jeunes orpailleurs qui ne seraient pas contre un peu de compagnie féminine. «Il n’y a pas de femmes ici. Au début certaines ont essayé de venir, mais les groupes armés les ont sommées de partir et de ne plus revenir», relate un jeune vendeur de boissons. Le respect de la discipline est strict. «Ici, même la vente d’alcool est strictement prohibée. Celui qui se ferait prendre à mener cette activité aurait de sérieux soucis», poursuit le même vendeur.
DE L’OR A TOUT PRIX – L’activité principale sur le site demeure bien l’orpaillage. Et le travail n’est pas de tout repos. Les conditions de vie des orpailleurs sont dignes de vrais survivants du Far West. La plupart s’abritent sous des tentes de fortune en bâches qui sont attachées à des piquets. C’est le décor presque partout. A défaut de tente, un abri de survie sous un arbre fait l’affaire de certains. «Le travail est dur ici. Nous montons dans les mines à 7 heures et nous revenons en début de soirée vers 18 heures», affirme un jeune orpailleur nigérien.
La poussière recouvrant les visages, les mineurs travaillent souvent sous un soleil ardent. Le travail est rythmé par les bips des appareils détecteurs de métaux et le bruit des coups de pioche qui fracassent les rochers. Tout le monde espère tomber sur un bon filon. Chose qui n’arrive pas tous les jours, même si la chance sourit, souvent, à quelques veinards. «L’autre jour, un gars est tombé sur un morceau de 4 kg d’or non loin de notre site», confie Ibrahim qui précise que, pour ce type de «grosse prise», les orpailleurs sont, souvent, obligés de partager avec les maîtres des lieux.
A coté de cette chance rare, certains orpailleurs s’en sortent autrement. Ils recueillent des tas de roches susceptibles de contenir des pépites d’or. Stockés dans des sacs, les graviers sont revendus à d’autres exploitants qui disposent de machines plus sophistiquées capables de concasser les graviers afin d’en extraire le métal jaune.
Cette exploitation de l’or n’est pas sans conséquences négatives. Bien qu’acteur de la pratique, Ibrahim se dit préoccupé par certains de ces aspects. «La Région de Gao ne profite pas vraiment de cette exploitation. La plupart des exploitants étant des étrangers, l’or est exporté », estime-t-il.
Il regrette, également, le péril environnemental que l’exploitation aurifère fait subir à la faune et à la flore locales. «Il y a des exploitants qui travaillent sans respect de la nature. Beaucoup d’arbres sont déracinés et de nombreux animaux tombent dans les trous laissés par les orpailleurs. A tel point qu’il est maintenant presque impossible de faire paître les animaux ici», soutient-il.
MT/MD (AMAP)