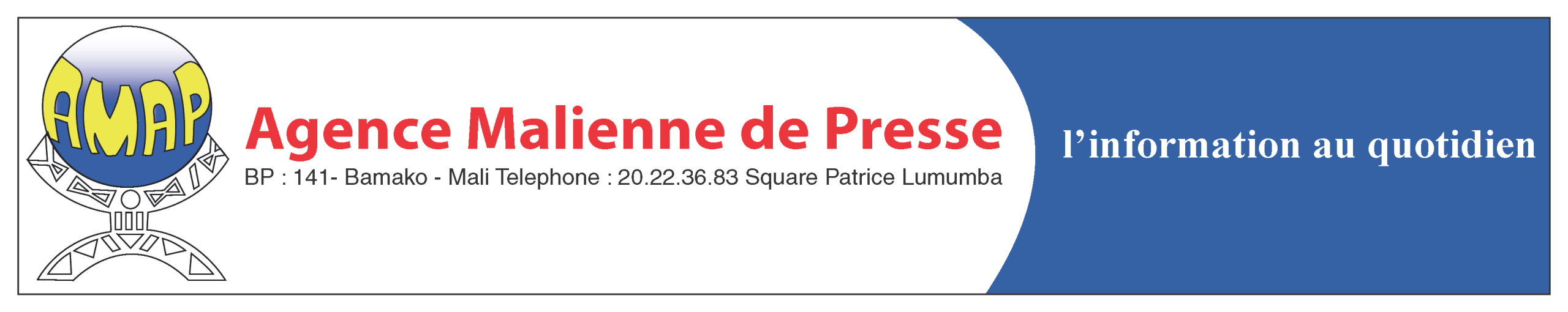Bamako, 19 nov (AMAP) L’étude diagnostic sur le nexus, paix, sécurité et changement climatique présenté mercredi par la Coalition malienne genre, sécurité et changement climatique (COMAGESC), lors d’un atelier de restitution, confirme que les femmes, « malgré leur rôle stratégique, restent très peu représentées dans les espaces de décision ».
Bamako, 19 nov (AMAP) L’étude diagnostic sur le nexus, paix, sécurité et changement climatique présenté mercredi par la Coalition malienne genre, sécurité et changement climatique (COMAGESC), lors d’un atelier de restitution, confirme que les femmes, « malgré leur rôle stratégique, restent très peu représentées dans les espaces de décision ».
Elles sont « peu propriétaires foncières. Peu consultées. Peu financées », a regretté la présidente de la COMAGESC, Mme Keita Aida M’bow, ex-ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, qui a présidé l’atelier. Selon elle, « cette étude nous montre, une fois de plus, que l’exclusion des femmes n’est pas seulement une injustice. C’est un risque en matière de paix, de sécurité et de développement », a fait remarquer la présidente de la COMAGESC.
« L’étude diagnostic dont les résultats seront restitués, aujourd’hui, apporte plusieurs contributions majeures parmi lesquelles on peut noter une analyse approfondie des vulnérabilités locales face aux risques sécuritaires liés au changement climatique dans les communes ciblées ; la mise en lumière du rôle central des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, mais aussi dans les stratégies d’adaptation climatique entre autres », a-t-elle dit.
Cette étude, qui a concerné trois régions : Bandiagara, Ségou et San et plus de 60 villages, a été réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Femmes maliennes mobilisées pour le climat, la paix et la sécurité » qui vise à mettre les femmes et les filles au cœur des stratégies d’adaptation aux changements climatiques et la prévention des conflits.
« Nous le savons tous : le Mali fait face, en ce moment, à une double vulnérabilité. D’un côté, les effets du changement climatique ne cessent de s’intensifier à travers la raréfaction des ressources en eau, la dégradation des terres, la perturbation des cycles agricoles. Et, de l’autre, l’insécurité persistante, notamment au Centre du pays, continue d’affecter les dynamiques communautaires et les moyens de subsistance », a-t-elle fait constater.
 « Ces deux crises se renforcent mutuellement. Elles fragilisent les communautés. Elles exacerbent les tensions autour des ressources naturelles. Et elles affectent en premier lieu les femmes et les filles », a-t-elle poursuivi. Ces victimes « sont agricultrices, transformatrices, responsables de la préservation de l’agro-biodiversité. Elles portent la survie des familles et des communautés. »
« Ces deux crises se renforcent mutuellement. Elles fragilisent les communautés. Elles exacerbent les tensions autour des ressources naturelles. Et elles affectent en premier lieu les femmes et les filles », a-t-elle poursuivi. Ces victimes « sont agricultrices, transformatrices, responsables de la préservation de l’agro-biodiversité. Elles portent la survie des familles et des communautés. »
Pour sa part, Henrielle Djinsu Mondjo, représentante du coordonnateur par intérim du Secrétariat du Fonds pour la consolidation de la paix (PBF), elle a déclaré : « cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet : femmes maliennes mobilisées pour le climat, la paix et la sécurité, financé par mon service, avec un budget de plus d’un milliard de Francs CFA et mis en oeuvre par des partenaires » comme le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
Elle a rappelé que son service investit dans la paix et la cohésion sociale au Mali, depuis 2014. En une décennie, l’investissement total du PBF s’élève à plus de 55 milliards de Francs CFA, traduisant l’engagement PBF « à appuyer les efforts du Gouvernement et du peuple maliens pour une paix durable. »
Conformément aux priorités nationales, « ce projet entend placer les femmes et les jeunes filles au centre des stratégies d’adaptation et de prévention de conflits liés au changement climatique dans les sphères décisionnelles et économiques au Mali, a-t- elle dit.
Elle a expliqué que « d’après les conclusions de cette étude diagnostic, menée dans les six communes de mise en œuvre du projet, le constat est clair : le changement climatique bouleverse nos vies, accentue l’insécurité et aggrave les inégalités de genre, dans les zones étudiées. »
« 99% des personnes interrogées reconnaissent que l’environnement a changé. Les pluies se raréfient, les températures montent, les sols s’appauvrissent et les rendements agricoles chutent. Les impacts sont directs : baisse des récoltes, perte de bétail, manque de pâturages. Les agriculteurs et les femmes sont les plus touchés », a-elle rapporté.
Le lien avec l’insécurité est donc réel : « la raréfaction des ressources alimente les conflits agropastoraux, fragilise le tissu social et pousse les jeunes à migrer, parfois vers des groupes armés, entre autres », a souligné la représentante du coordinateur de PBF.
Elle a ajouté que « les premiers résultats de cette étude, bien que provisoires, nous révèle que le temps n’est plus aux constats. Il est à l’action. » « Ensemble, nous devons transformer ces défis en opportunités en faisant du climat et de la paix une seule et même priorité, en agissant maintenant, pour un Mali résilient, inclusif et en paix », a conseillé Henrielle Djinsu Mondjo.
ST/MD (AMAP)