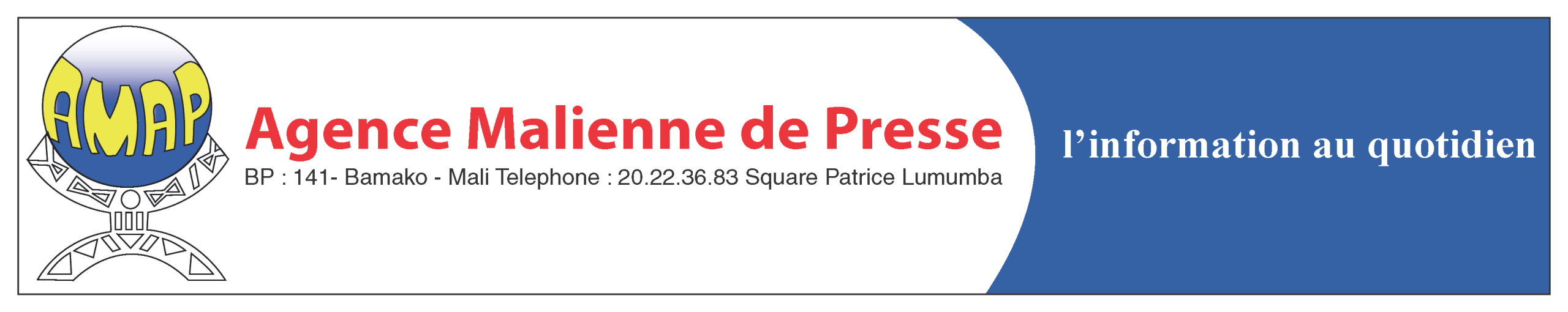Par Siné S. TRAORE
Par Siné S. TRAORE
Au Mali, les interdits sociaux sont omniprésents dans toutes les ethnies et sous toutes les facettes de la vie traditionnelle. Mais, à l’ère de la modernité sans frein, ces interdits revêtent-ils encore une valeur sacrée aux yeux de la jeune génération ?
Bamako, 02 juin (AMAP) Une mère déconseille à son fils de se marier avec une jeune fille. Le garçon transgresse l’interdit. Quinze ans de mariage, le couple n’a toujours pas d’enfant. La société a vite fait de mettre cela sur le compte des conséquences de l’interdit qui a été franchi !
Dans une discussion sur le sujet, un grand-frère sociologue a fait noter que depuis des siècles, au Mali, les communautés, les rites et la culture vivent au rythme d’un certain nombre d’interdits sociaux codifiés par la tradition. Ces interdits, qui régulent, pour ainsi dire, le fonctionnement même de la communauté, sont si ancrés dans les croyances et les comportements, qu’ils sont considérés comme un héritage de valeurs sacrées léguées par les aïeux.
De Kayes (Ouest) à Kidal (Nord), dans les vestibules des villages du Mandé ou sous les tentes accueillantes des Arabes de Tombouctou, il y a une réalité qui frappe tout visiteur, un tant soit peu observateur. Cette réalité, héritée des us et coutumes transmis de génération en génération : les interdits sociaux rythment la vie des populations. Etablis par les ancêtres, afin d’atteindre l’équilibre et la cohésion sociale, ces règles non écrites sont comme une boussole de la personnalité de l’Homme malien dans ses rapports avec ses prochains, avec la nature.
Parmi ces interdits, on peut citer : « le fait de parler la bouche pleine » ; « fixer un aîné dans les yeux lorsque vous lui parlez » ; « trainer dans la rue au crépuscule »; « enjamber son époux » ; « balayer la nuit », « répondre étant dans les toilettes » etc. En passant la société malienne à la loupe, l’on se rend compte que, s’il y a quelques interdits qui semblent communs à presque toutes les cultures, la plupart du temps, chaque aire culturelle a ses interdits spécifiques. Ainsi, selon que l’on soit chez les Dogon, les Minianka, les Bwa ou les Soninké etc. ; ce qui relève de l’ordre de l’interdit absolu aux yeux d’une ethnie, peut être appréhendé comme une pratique tolérée aux yeux d’une autre. D’ailleurs, il est fréquent de voir que des interdits sont liés à une famille, à un clan, à une tribu, à un village ou une ville.
FAIS-ÇI, FAIS-ÇA, FAIS SEULEMENT – Selon le Pr Mohamed Tounkara, qui enseigne la psychologie à l’École normale supérieure (ENSup), les interdits sont là comme des signaux d’alerte pour empêcher quiconque d’outrepasser ses droits et de tomber dans une forme de chaos comportemental. Il cite, par exemple, « la consommation d’œufs de poule par les enfants », « le coït entre un homme et une femme dans la brousse, en milieu Bwa », « le bain corporel au crépuscule pour une femme enceinte », ou encore « la consommation de la viande de rat par une femme en état de grossesse ». Le spécialiste affirme que les interdits jouent carrément un rôle de garde-fous destinés à préserver les valeurs morales de la société. « Un des avantages des interdits est de protéger la société et ses acquis mais, aussi, d’assurer un certain équilibre ou cohésion sociale, ainsi que le respect des normes et des valeurs », fait-il remarquer.
Poussant plus loin dans ses explications, le Pr Tounkara analyse certains interdits comme de simples astuces dont le but est d’empêcher certains abus et non comme des émanations liées au sacré. Il revient, à ce propos, sur l’interdiction faite aux enfants de s’approprier des œufs. « Faire croire aux enfants qu’ils ne doivent pas consommer les œufs de poule n’a d’autre signification que de permettre aux poules d’élever leurs poussins. Les anciens ont ainsi imaginé cette menace pour freiner la voracité des enfants et laisser le temps aux poules d’éclore leurs œufs », explique-t-il.
Mais, posons-nous une question ! Qu’advient-il si un interdit est allégrement violé par un membre de la société ? Le Pr Tounkara souligne que des sanctions sont souvent prises. Par exemple, cite-t-il, « pour le cas du coït entre un homme et une femme dans la brousse, en milieu Bwa ; les présumés fautifs sont punis publiquement, le jour de foire du village. » Et Tounkara d’ajouter : « Ils, les fautifs, peuvent aussi être contraints d’amener un bouc ou une chèvre que les sacrificateurs égorgeront pour en extraire la graisse. Cette graisse sera fondue sur du feu puis le liquide graisseux brûlant sera déversé sur les parties intimes des deux coupables. » « Cette pratique punitive, nous dit Tounkara, permettra de soulager les « dieux » de la brousse ou de la nature, car ceux-ci auront été offensés et la nature également souillée. » « Sans cela, précise le Pr Tounkara, les Bwa prédisent que l’hivernage risque de se passer sous de mauvais augure et ne sera pas très pluvieux ».
Tounkara souligne que des sanctions sont souvent prises. Par exemple, cite-t-il, « pour le cas du coït entre un homme et une femme dans la brousse, en milieu Bwa ; les présumés fautifs sont punis publiquement, le jour de foire du village. » Et Tounkara d’ajouter : « Ils, les fautifs, peuvent aussi être contraints d’amener un bouc ou une chèvre que les sacrificateurs égorgeront pour en extraire la graisse. Cette graisse sera fondue sur du feu puis le liquide graisseux brûlant sera déversé sur les parties intimes des deux coupables. » « Cette pratique punitive, nous dit Tounkara, permettra de soulager les « dieux » de la brousse ou de la nature, car ceux-ci auront été offensés et la nature également souillée. » « Sans cela, précise le Pr Tounkara, les Bwa prédisent que l’hivernage risque de se passer sous de mauvais augure et ne sera pas très pluvieux ».
UNE CONSTRUCTION HUMAINE – Cependant, peut-on situer avec exactitude l’origine des innombrables interdits qui ponctuent la vie sociale malienne ? Pour le Dr Fodé Moussa Sidibé, enseignant-chercheur et traditionnaliste, les interdits naissent, en réalité, à partir de l’observation des habitudes sociales. Dans leur démarche d’observateurs mais, aussi, de gardiens de la cohésion sociale, les ancêtres ont alors pris l’habitude de frapper d’interdiction toute attitude qu’ils jugeaient dangereuse pour l’harmonie du vivre-ensemble. « Tous les interdits ont été institués selon l’expérience de vie de la communauté. Leur but ? Maintenir le vivre-ensemble et tisser des liens entre les uns et les autres », révèle Dr Fodé Moussa Sidibé.
Selon lui, en principe, tous les interdits ont des conséquences directes ou indirectes, qu’on n’y croit ou pas, selon la tradition. « Parce que dans plusieurs cas, quand on dit que telle chose est interdite, les gens posent la question. « Mais pourquoi c’est interdit ? » Souvent, on ne répond pas parce que ce sont des lois non écrites de la société auxquelles on doit se plier, si nous voulons être un élément central de la société », explicite-t-il.
« Les interdits, souligne, le traditionnaliste Sidibé, ont ceci de positif qu’ils servent, très souvent, aussi, à préserver la faune et la flore. » « À certaines périodes, il se peut qu’une espèce végétale ou animale existe en abondance. Mais, dès le moment où les ancêtres jugent que les gens commencent à faire une exploitation abusive de ladite espèce, alors, le couperet de l’interdit tombe afin de protéger l’espèce en question et éviter qu’elle ne disparaisse », fait savoir Dr Sidibé.
Pour notre interlocuteur, la négligence ou l’abandon progressif de beaucoup d’interdits explique pourquoi la société malienne connaît actuellement d’innombrables maux tels que certaines formes de délinquance ou de dépravation liées à la sexualité. « Un exemple simple de dépravation de mœurs dans notre société : le fait de courir derrière des filles. Ce faisant, le garçon qui se permettait de déflorer une fille, celui-ci était obligé de quitter le village pour toujours parce qu’il avait osé enfreindre un interdit. Et on prenait des sanctions sévères qui permettaient de bien réguler notre société », estime Dr Sidibé.
Selon lui, l’interdiction a toujours des avantages. « C’est cela la connaissance de soi dans la société et celle des autres, le respect de soi et celui des autres. Quand je sors de chez moi, je dois respecter des interdits qui sont liés à mon statut social », enseigne le traditionnaliste.
Sékou Diabaté, griot de son état, loue à son tour le principe des interdits sociaux mis en place par nos aïeux. « Chez nous, au Mali, ce qui est bien avec les interdits sociaux, c’est qu’ils vont jusqu’à préserver les droits des animaux. N’est-ce pas formidable ? Car, même les droits des animaux doivent être respectés. J’en veux pour preuve l’interdiction de faire la chasse à une période qui coïncide avec la fécondation de plusieurs bêtes. Un principe qui vaut également pour la pêche », explique le communicateur traditionnel. M. Diabaté est de ceux qui sont pour la mise en place d’une campagne de sensibilisation visant les jeunes. Campagne dont la thématique portera, évidemment, sur la portée des interdits sociaux et leurs effets sur l’éducation aux valeurs qui manquent tant à notre jeunesse.
Pourquoi cela ? Le griot répond, catégorique : « Les parents doivent apprendre davantage à leurs enfants le respect et l’observation des interdits. Car, seul l’observance des interdits est le remède le plus efficace à la déviance généralisée de comportements que nous voyons chez nos jeunes aujourd’hui. »
ST/MD (AMAP)
Encadré
 Souvent dans la société traditionnelle au Mali, on vous dit : « ça, c’est interdit mais on ne vous en donne pas la ou les raison ». « A mon humble avis, quand on vous dit que quelque chose est interdit, il ne faut pas en chercher les raisons, il faut accepter l’idée. Aujourd’hui, on peut dire que la société est complètement est à la recherche de presque tous ses repères », explique Yoroba Cissé, enseignant.
Souvent dans la société traditionnelle au Mali, on vous dit : « ça, c’est interdit mais on ne vous en donne pas la ou les raison ». « A mon humble avis, quand on vous dit que quelque chose est interdit, il ne faut pas en chercher les raisons, il faut accepter l’idée. Aujourd’hui, on peut dire que la société est complètement est à la recherche de presque tous ses repères », explique Yoroba Cissé, enseignant.
« Auparavant, les personnes âgées, les parents, toute la société éduquait les enfants. Aujourd’hui, nous en sommes loin, vaincus par l’individualisme parce que chacun veut garder son enfant pour soi. Quand un enfant fait des écarts, dans la rue, vous ne pouvez plus le corriger, vous ne pouvez rien lui interdire, sinon, vous aurez à faire avec ses parents », ajoute l’éducateur.
Il explique, également, que ce phénomène n’est pas normal, mais, c’est ce que tout le monde observe de nos jours, « parce que l’enfant n’est plus pour tout le monde », il appartient à ses seuls parents biologiques.
Dans un passé lointain, l’enfant ne pouvait pas rentrer en larmes à la maison, après avoir été corrigé pour un mauvais comportement dans la rue : « tu pleures dans la rue, tu sèches tes larmes dans la rue ». « Sinon, une fois rentré, les parents en ajoutait à la correction. C’était ça l’éducation en réalité », dit-il, avec regret.
« Moi, je me souviens, à Sikasso, jeune, j’ai connu un vieux qui vient d’une famille très respectable. Il avait son fouet dans sa voiture. Chaque fois qu’il était témoin de bêtises d’un enfant, il descendait de son véhicule pour le corriger et continuer son chemin. Personne ne disait mot. Tout Sikasso acceptait cela, parce qu’il remettait les enfants dans le droit chemin », dit notre interlocuteur.
« Aujourd’hui, on vous conduirait à la police pour cela. Nous sommes en train de nous occidentaliser. D’une manière ou d’une autre, il nous faut revenir à nos traditions », ajoute-t-il.
« La faute incombe à la nouvelle génération de parents, parce qu’elle pense que l’enfant est pour elle seule, alors que seule, on ne peut pas l’éduquer », accuse M. Cissé.
ST/MD (AMAP)