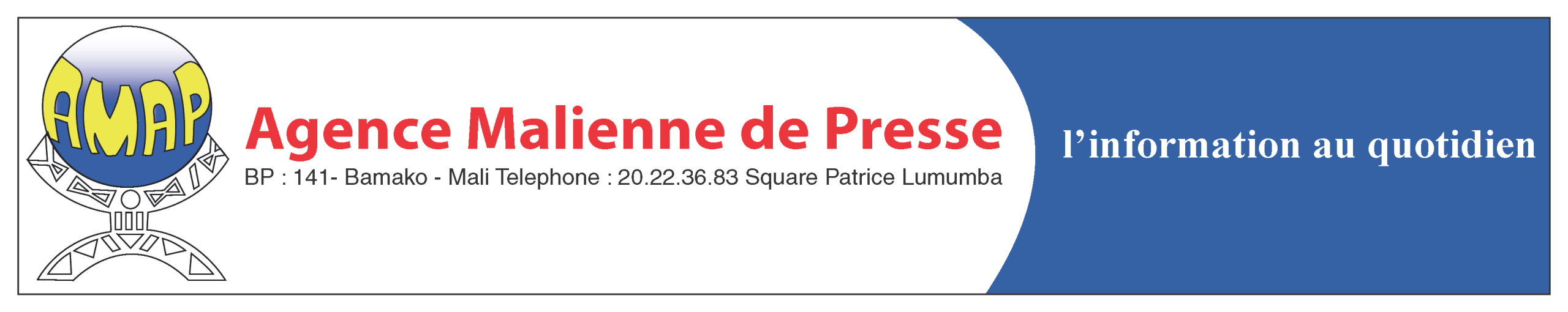©ÊOUMAR DIOP, AMAP, FAIT DIVERS, LES CORPS DES TROIS BRAQUEURS DE MOTO, TUES PAR LA POPULATION LE 07/05/2012 EN FACE DE LA MAIRIE DE DIALAKOROBOUGOU.
Par Bembablin DOUMBIA
Bamako, 16 août (AMAP) Bamako, au mois d’avril. Le Ramadan tire vers sa fin. Un lundi, il est environ 4 heures du matin, à Faladjè en Commune VI de la capitale malienne. Au moment où certains se préparent à prendre leur «shour» (le repas de l’aube pour les jeûneurs), deux présumés voleurs de basin sont poursuivis par des jeunes du quartier. «Aw yé sòn minè !», arrêtez les voleurs !», crient-ils à l’antienne.
Presque tout le secteur s’est réveillé en sursaut par cette clameur publique. Le doux et agréable sommeil des paisibles habitants s’est arrêté brusquement pour vite laisser place au bruit et à la clameur. Quelques curieux ouvrent leurs portes pour être parmi les témoins oculaires.
Quelques instants plus tard, les jeunes arrivent à mettre la main sur l’un des deux «malfrats», qui se fait rouer de coups jusqu’au sang. Son «complice», armé de pistolet, parvient à s’échapper, en menaçant la foule avec son arme. Aux environs de 5 heures 30 minutes, pendant que des musulmans accomplissaient la prière de l’aube, dans une mosquée du quartier, des agents du commissariat de police du 10è arrondissement et de la protection civile interviennent pour extirper le voleur lynché de la fureur de la foule. «Laissez-le pour qu’on l’achève», fulminent encore certains badauds, visiblement écœurés de constater que le délinquant est toujours en vie.
Cette scène est fréquente à Bamako. Les populations sont enclines à se rendre justice, chaque fois qu’un voleur ou présumé tel se fait alpaguer. Signe patent du déficit de confiance en notre système judiciaire. Nombre de citoyens pensent qu’en remettant les délinquants aux forces de l’ordre, ceux-ci seront libérés sans connaitre la rigueur de la loi.
Celui que nous désignons sous les initiales de O.K fait partie de ces partisans de la justice privée. Il explique crûment, à qui veut l’entendre, être un adepte de la mise à mort systématique des voleurs. Pour ce trentenaire, la plupart des malfrats sont des «criminels» qui utilisent les armes à feu et n’hésitent pas à s’en servir contre leurs victimes. Notre interlocuteur estime que si on conduit ces individus à la police, ils seront relâchés. D’après lui, ces délinquants « économisent de l’argent pour qu’en cas d’arrestation par les forces de l’ordre, ils puissent sortir.
O.K fait remarquer que certains malfrats demandent, parfois, de les remettre à la police. Il raconte une anecdote selon laquelle un présumé voleur a été un peu aspergé d’essence par des lyncheurs. Tout effrayé, le délinquant a prié le ciel de le livrer à la police. Peine perdue ! «Il a finalement été tué par ses bourreaux», rapporte O.K.
Une autre interlocutrice, qui éprouve un sentiment mitigé face à la pratique, raconte ce qui s’est passé dans leur quartier, une nuit, quand un présumé voleur a été arrêté par les voisins qui voulaient mettre fin à sa vie. «Quand nous avons entendu les bruits dans la rue, nous nous sommes réveillés. Ainsi, deux porteurs d’uniforme de notre maison sont sortis pour sauver le délinquant et le remettre à la police», raconte la dame. Signalant qu’à cause de cette situation, leur famille a été «traitée de tous les noms d’oiseaux» par la foule en furie. Ironie du sort : quelques jours après notre entretien, la moto de notre interlocutrice a été volée.
Des situations ont failli tourner au drame, à cause de cet acte extrajudiciaire. B.C. habite dans un quartier de la rive droite du fleuve Djoliba, dans la capitale malienne. Le jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, explique avoir failli perdre un frère. Le «pauvre» est sourd-muet. Ce jour-là, il est sorti vers 5 heures du matin pour récupérer des oiseaux avec une connaissance. «Au retour, mon frère est tombé sur notre mère dans la cour. Par peur, il s’est glissé sous le véhicule. Du coup, notre maman a crié au voleur. C’est ainsi que pour le faire sortir de sa cachette, nous avons commencé à lui jeter des cailloux. C’est après qu’il a crié de toutes ses forces que nous l’avons reconnu», raconte B.C, en hochant la tête. Il avait été blessé et transporté à l’hôpital où il lui a été diagnostiqué une thrombose (caillot de sang) dans la poitrine. B. C explique que son frère s’est aujourd’hui bien rétabli. Heureusement !
HISTORIQUE – Sur la question, l’enseignant-chercheur Dr Seydou Loua rappelle que cette pratique du lynchage a commencé dans les années 90-91, avec les mouvements de contestation qui ont fait partir l’ancien président, le général Moussa Traoré. « A l’époque, rappelle-t-il, on l’appelait «L’article 320 (qui correspondait à 300 Fcfa de litre d’essence et 20 Fcfa pour la boite d’allumettes». Ainsi, les gens ont commencé à se rendre justice. Cela a continué aujourd’hui jusqu’à aujourd’hui, pratiquement, un peu partout au Mali.
 D’après l’universitaire, ce phénomène est dû à certaine frustration de la population quelle explique par le fait que lorsque les présumés voleurs arrivent à la police ou à la justice, souvent par manque de preuves, ils sont relâchés. Et, une fois libérés, ces derniers «reprennent du service». «Donc, la population, à un moment donné en a eu assez et a décidé de se rendre justice elle-même», soutient Dr Seydou Loua.
D’après l’universitaire, ce phénomène est dû à certaine frustration de la population quelle explique par le fait que lorsque les présumés voleurs arrivent à la police ou à la justice, souvent par manque de preuves, ils sont relâchés. Et, une fois libérés, ces derniers «reprennent du service». «Donc, la population, à un moment donné en a eu assez et a décidé de se rendre justice elle-même», soutient Dr Seydou Loua.
« Il y a aussi le fait que certains présumés voleurs tuent des gens lors de leurs actes », ajoute notre interlocuteur. Cependant, selon l’universitaire, il existe souvent des cas d’erreur. «Il y a des gens qui ont été lynchés à mort et après on s’est rendu compte qu’ils étaient des innocents», déplore l’enseignant-chercheur.
Parfois, les gens sont lynchés pour un rien. M. Loua raconte que dans son quartier, un jeune a été brûlé pour avoir volé un sac de charbon. Pour juguler ce phénomène, l’universitaire pense qu’il faut rendre, réellement, la justice lorsqu’un délinquant se fait attraper. «Parce que les populations ne vont pas arrêter le lynchage tant que les présumés voleurs se feront libérer deux ou trois jours après leur arrestation pour récidiver», déclare Dr Seydou Loua.
Selon lui, la police doit, aussi, faire son travail de prévention, en intensifiant les patrouilles et les enquêtes afin de diminuer considérablement les vols.
VICTIMES INNOCENTES – Pour sa part, le président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Aguibou Bouaré, souligne que la loi interdit à toute personne de se rendre justice, quel que soit l’acte que «l’on pourrait reprocher à l’agresseur ou le préjudice que l’on nous aurait causé». D’après lui, les cas de légitime défense ou d’autorisation de la loi sont strictement réglementés.
Selon notre interlocuteur, la recrudescence des pratiques de justice expéditive peut s’expliquer – mais ne jamais se justifier – « par le sentiment d’impunité que certaines populations fustigent et dénoncent». «Il n’est pas rare d’entendre certains individus affirmer que lorsqu’ils appréhendent les présumés voleurs et autres délinquants, ceux-ci seraient relâchés et bénéficieraient d’une certaine impunité», fait savoir M. Bouaré.
Et d’aucuns estiment que les procédures judiciaires sont lentes et souvent trop «clémentes» à leurs yeux. «En tout état de cause, rien ne pourrait justifier la justice expéditive. Rendre la justice relève de la prérogative exclusive du pouvoir judiciaire en matière pénale», estime le patron de la CNDH.

Le président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Aguibou Bouaré
Pour lui, ces exactions constituent des atteintes aux droits à la sécurité, à l’intégrité physique voire à la vie. «La justice expéditive peut faire des victimes innocentes dans la confusion, y compris dans les cas supposés de flagrant délit», pense M. Bouaré. Il a dit que les populations devraient comprendre qu’au-delà de l’infraction que constituer, nul n’est à l’abri de telles pratiques au gré des circonstances hasardeuses. «Il suffit de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment», dit le président de la CNDH.
Nous avons tenté de faire réagir les services de police sur la question. En vain ! Cependant, nous avons pu nous entretenir avec le substitut du procureur de la République près le tribunal de la Commune IV du District, Amadou Seydou Bocoum. Le magistrat indique, clairement, qu’aucune personne ne doit se rendre justice. Ajoutant que cette tâche revient aux seuls magistrats. «Donc, lorsque vous décidez de rendre justice par vous-même, vous faites entrave à la bonne marche des services judiciaires. Et du coup, plusieurs infractions peuvent naître de votre action», explique-t-il. Par exemple, lorsque quelqu’un appréhende un présumé voleur, le ligote et le garde, il peut être coupable «d’arrestation illégale et de séquestration».
Amadou Seydou Bocoum déplore le fait que certains de nos compatriotes s’adonnent à des actes de violence sur les présumés voleurs. «Dès lors qu’il n’y a pas de décision de justice qui condamne quelqu’un, on ne peut le qualifier de voleur», précise le juriste.
«Les magistrats et les policiers sont des professionnels, formés dans ce domaine. Ils jugent en fonction des faits qui leur sont présentés et de ce que dit la loi», souligne M. Bocoum. Selon lui, parmi les personnes qui sont présentées devant eux, il y a des innocentes. «Quand quelqu’un commet une infraction, ce qui est sûr, il sera condamné. Mais à défaut, le juge doit avoir le courage de le libérer», déclare sans ambages le magistrat.
Pour lui, l’inconvénient de recourir à la justice expéditive, c’est qu’en prenant quelqu’un pour responsable de quelque chose, si on le tue et après il s’avère qu’il est innocent, on ne pourra jamais lui redonner la vie. « Or, quand on confie la personne au juge, aux policiers, ceux-ci ont la latitude de faire des enquêtes qui sont nécessaires pour établir sa culpabilité ou son innocence », affirme le magistrat.
BD/MD (AMAP)
LES PEINES APPLICABLES AU VOL
Pour mieux cerner l’infraction de vol, selon le substitut du procureur de la République près le tribunal de la Commune IV, il faudra remonter jusqu’à la Constitution du 25 février 1992 qui, en son article 13, garantit le droit de propriété. Ainsi, les rédacteurs du Code pénal, dans le souci de mettre cette garantie en œuvre, ont prévu plusieurs infractions réprimant de nombreuses formes d’atteinte audit droit, au nombre desquelles nous pouvons citer le vol.
D’après Amadou Seydou Bocoum, le vol est défini à l’article 252 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse du bien d’autrui. S’agissant du vol simple, il est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 180.000 à 1.800.000 Fcfa. Quant au vol qualifié, la peine est de 5 à 20 ans de réclusion, de la réclusion à perpétuité ou pire de la peine de mort.
- D.