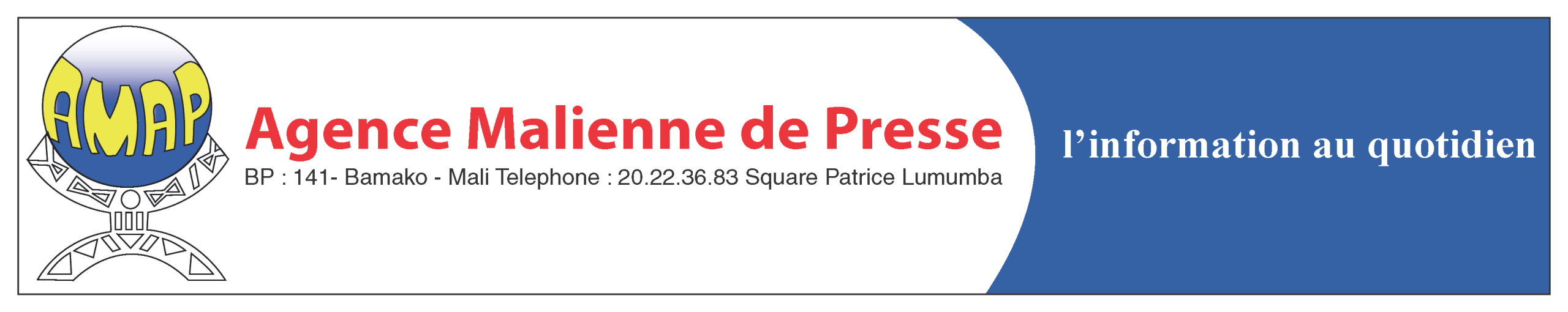Par Ouka BA
Par Ouka BA
Diéma, 19 nov (AMAP) Dougoukolo Konaré, le père de l’ancien président du Mali, Alpha Oumar Konaré, fut le premier directeur de l’école de Diéma, qu’il dirigea de 1935 à 1940. A l’époque, l’école était faite en pailles pour recevoir une minorité d’élèves dont les parents étaient contraints de les y inscrire. A partir de 1951, l’établissement a changé de physionomie avec la construction de six salles de classe en pierres.
Bâtie sur une superficie d’un hectare, l’école est située aux abords de la route asphaltée qui mène au quartier Razel, non loin de la mare Lambakoré.
Selon Yassa Konté, ancien député, qui a dirigé l’école de Dougoukolo Konaré pendant quatre ans, de 1994 à 1998, sa « construction n’a pas été de tout repos ». « Le transport des pierres, du sable, du gravier et autres matériaux était assuré par des gaillards. C’était une véritable corvée », dit-il, assis dans le vestibule du chef de village.
Pour le recrutement des élèves, les carnets de famille permettaient de faire le recensement. Les filles, elles, en étaient épargnées. Chaque année, à l’ouverture des classes, le commandant ordonnait de recenser tous les enfants ayant atteint l’âge d’être scolarisé. « Toutes les familles se pliaient à cette décision. Chaque enfant était soumis à une visite médicale. Si la visite médicale révélait qu’un enfant est inapte, ses parents s’en réjouissaient. Leur souhait était que leur progéniture reste à leurs côtés pour les aider dans les travaux champêtres. L’idée d’école était rejetée par tous dans ce milieu, comme d’ailleurs partout », se souvient Yassa Konté.
L’ancien député n’en finit pas de se désoler devant la démolition d’un pan de la véranda de l’école de Dougoukolo Konaré, vers son côté sud. « Quand j’ai été nommé directeur de cet établissement, dit-il, il y avait une véranda commune qui entourait les salles de classe. Cette partie de la véranda, qui a été cassée, empêchait les rayons de soleil de pénétrer dans les salles à une certaine heure de la journée », dit-il.
Salihou Soukouna, professeur d’anglais à la retraite et ancien élève de cette école, se souvient des activités intenses de maraîchage qu’on y pratiquait. « La moitié de l’espace du jardin maraîcher était occupée par des arbres fruitiers. Chaque élève s’occupait de l’entretien d’une planche. Le jardin était approvisionné en eau à partir de la mare Lambakoré. Les recettes générées par cette activité étaient versées directement dans la caisse de la coopération de l’école », se remémore notre interlocuteur.
Sur le tableau de succession accroché dans le bureau du directeur, il est mentionné que depuis 1935, dix-sept directeurs d’école se sont succédés. Selon l’actuel titulaire, Adama Togola, à partir de 1998, l’école qui était un cycle complet, a été scindée. Le premier cycle A et le premier cycle C. Le second cycle A et le second cycle C.
Les six salles de classe de l’école de Dougoukolo Konaré sont devenues vétustes. Le toit conserve les mêmes tôles qui sont rouillées et détachées en plusieurs endroits par les intempéries.
Le président du Comité de gestion scolaire de l’école fondamentale premier cycle A de la ville de Diéma, Bougary Konaté, soixante onze ans, est un ancien élève de l’école de Dougoukolo Konaré. « Quand je fréquentais cette école, Dougoukolo Konaré, n’était plus là. Il était parti pour Markala, dans la Région de Ségou, d’après ce que j’ai appris », dit Bougary.

En 1951, l’établissement a changé de physionomie avec la construction de six salles de classe en pierres
« Mon père était un ancien caporal de l’Armée. En 1963, il m’a inscrit à l’école. J’avais déjà dépassé l’âge de la scolarisation. La discipline était de rigueur dans notre école. Les élèves apprenaient sous le fouet que brandissait le maître d’école », a dit M. Konaté.
« Le châtiment corporel était de rigueur. Si un élève commettait une faute grave, il était sérieusement corrigé. Et quand son père en était informé, il rudoyait, à son tour, l’enfant, comme si la punition infligée par le maître ne suffisait pas. L’enfant appartenait à toute la société. Tout le monde pouvait contribuer, à sa guise, à son éducation », se souvient-il.
Et de regretter que « les choses ne soient plus comme avant : aujourd’hui, personne n’a le droit de porter la main sur un enfant d’autrui, encore moins de l’insulter ». « A mon avis, si nous sommes assaillis par ces nombreux problèmes aujourd’hui, c’est à cause surtout de la mauvaise éducation de nos enfants », dit-il.
DE BONNE VOLONTÉS – Une ONG a financé la construction et l’équipement de trois salles de classe, une direction avec magasin et des blocs de latrine. La clôture de l’école et la réalisation du jardin d’enfants, situé à proximité, font partie du lot des réalisations de la même ONG caritative.
L’association Kaarta Karalemou Kassoun Kahoo, de Mme Sokona Semega, a récemment procédé, sur fonds propres, à la restauration du sol des trois salles de classe de l’école, à la réfection des tableaux ainsi qu’à la réparation des portes et fenêtres.
L’établissement scolaire est confronté à une insuffisance de tables-bancs et compte un effectif pléthorique d’élèves. Les élèves de la première année du premier cycle C, étudient en plein air, en attendant la confection d’un hangar de fortune.
Il est temps, pensent certains, de baptiser, officiellement, l’établissement « Ecole Dougoukolo Konaré », en guise de reconnaissance à cet éminent instituteur qui a donné le meilleur de lui-même, souvent dans des conditions difficiles, pour inculquer son savoir aux plus petits.
L’école de Dougoukolo Konaré a vu le jour, durant la période coloniale, quand rares étaient les parents qui acceptaient de conduire librement leur progéniture à l’école. Aller à « l’école des Blancs » était un signe de malédiction pour certains qui pensaient que c’était la pire des façons de transformer leurs enfants, d’en faire des « fainéants », des « bons à rien ».
Cependant, l’école était une obligation pour tous. Personne ne pouvait y échapper. L’administration coloniale veillait scrupuleusement sur la scolarisation des enfants. Les parents les plus nantis donnaient les noms des enfants de leurs subordonnés, ceux placés sous leur autorité. L’école à leurs yeux n’avait aucun sens, aucune importance. Seul l’apprentissage du Coran, capable de sauver les âmes et le corps des feux de la géhenne, comptait pour nos ancêtres. Certains cachaient leurs enfants ou les faisaient fuir, pour échapper à l’école. Quand ces mêmes enfants, qui partaient apprendre les connaissances des blancs, revenaient occuper les postes de hauts fonctionnaires, beaucoup ont, de regret, « mordu leur doigt », comme on le dit souvent.
OK (AMAP)