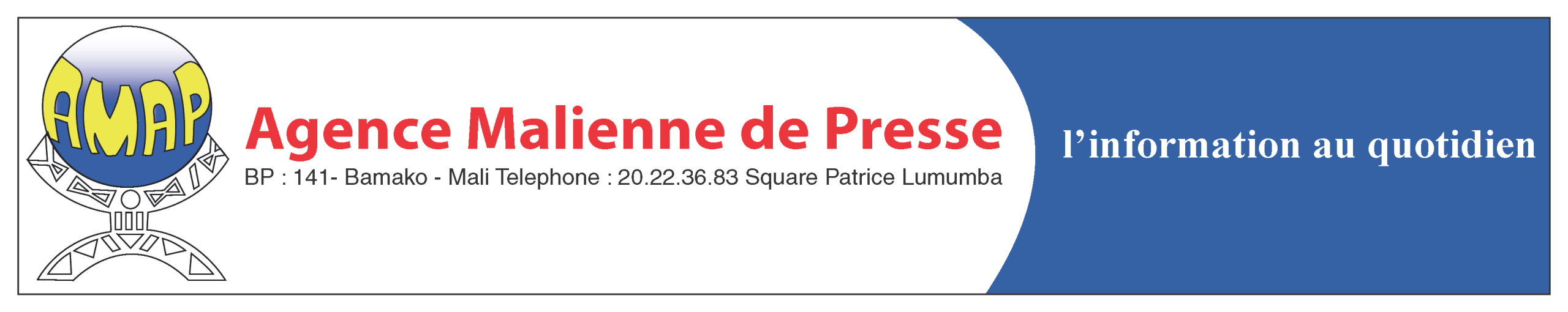Par Mamadou SY
Par Mamadou SY
Ségou, 18 mai (AMAP) Le service de la pêche a pour rôle l’appui conseil, et le contrôle de la réglementation en vigueur. Selon Baréma Koïta, chef du secteur pêche de Ségou, la pisciculture en tant que technique d’élevage de poisson a vu le jour au Mali par l’initiation d’une petite station piscicole expérimentale dans la Région de San. La convention de financement l’instituant a été signée en novembre 1979 entre le gouvernement de notre pays et celui des États-Unis avec l’appui de l’USAID. C’est ainsi qu’une antenne de vulgarisation a été créée à Niono, dans la zone Office du Niger, en raison de la disponibilité en eau et des sous-produits agroalimentaires. Depuis, une multitude de techniques dont la rizipisciculture et la pisciculture en cage ont été testées et adaptées en milieu rural, a-t-il rappelé.
Concernant les infrastructures piscicoles, le Cercle de Ségou compte actuellement 131 étangs et 115 bacs hors sol et 2 cages flottantes. La rizipisciculture combinant la culture du riz et l’élevage de poissons, couvre une superficie de 7.500 m2, tandis que les mares sont au nombre de 31 et s’étendent sur 51,68 hectares, a détaillé Baréma Koïta. Les performances enregistrées ces dernières années se situent au niveau des cages flottantes et bacs hors sols. Pour une cage flottante de 144 m3 la production obtenue a été de 2.624 kg pour 10.000 alevins. Quant au bac hors sol de 10 m3 avec 1.000 poissons, il a permis de récolter 369 kg, a souligné le chef du secteur pêche de Ségou.
Les tilapias nilotica (Ntèbèfing) et les clarias gariepinus (Manogo) sont les deux espèces ayant fait l’objet d’études positives en ce qui concerne la pisciculture dans notre pays. Parmi les initiatives en cours pour soutenir la pisciculture à Ségou, figurent le Projet de restauration des terres dégradées (PRTD), celui de l’appui à l’amélioration des moyens d’existence durable d’atténuation et d’adaptation des communautés de pêche face aux changements climatiques et Jègè ni Jaba (JNJ), a fait savoir Baréma Koïta.
S’exprimant sur les difficultés, le chef du secteur pêche de Ségou dira que l’acquisition des intrants par les producteurs demeure une préoccupation. En outre, sa structure ne compte pas suffisamment d’agents pour couvrir tout le cercle et l’accès à certaines localités est entravé par l’insécurité grandissante. Le service de la pêche de Ségou fait également face à une insuffisance de moyen financier. Baréma Koïta pense que pour tirer profit de la pisciculture, il faut « favoriser l’accès aux intrants de qualité à un prix raisonnable, disposer d’une source d’eau permanente, suivre régulièrement l’entretien des infrastructures et sécuriser le dispositif contre le vol ». Parlant des défis et perspectives, il a évoqué la réduction du coût des intrants, l’aménagement des infrastructures piscicoles et le renforcement des capacités des producteurs.
MS/MD (AMAP)