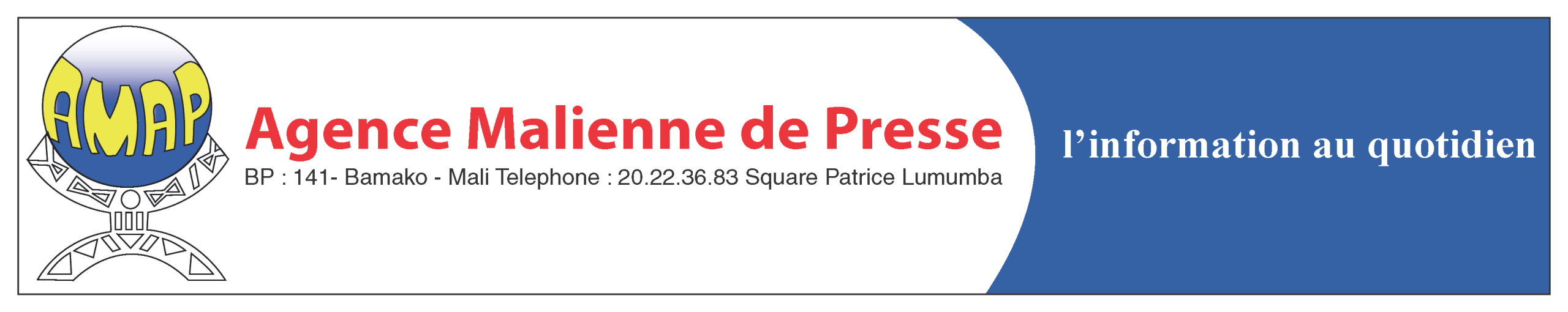Par Ouka BA
Par Ouka BA
Diéma août (AMAP) Le baobab, cet arbre aux multiples vertus est, surtout, entretenu à cause de ses feuilles, que les femmes réduisent en poudre pour la préparation de la sauce du tô, ou pour rendre malléable le couscous.
Dans le Cercle de Diéma, dans l’Ouest du Mali, particulièrement dans les localités à dominance soninké, le baobab est considéré comme un patrimoine familial, exploité généralement par les femmes.
Chaque matin, quand le chef de famille sort du grenier la quantité de mil pour le plat du jour, en plus de la mesure de sel, il puise dans la réserve de poudre de feuilles de baobab, appelé « namougou fing ». Une fois que le maître de la maison réunit ces conditions, il est exempté de prix de condiments. C’est à la femme de se « débrouiller » seule pour trouver le reste des ingrédients et préparer à manger pour les membres de la famille.
Parfois, si le plat n’est pas du goût d’une belle-sœur ou d’un beau-frère, celle-ci ou celui-ci ne se prive de le faire savoir à la cuisinière du jour, à travers sarcasmes et propos blessants pour la pauvre ménagère, du genre : « Même un âne ne peut digérer un tel met ! »
Ici, comme un peu partout dans la zone, les feuilles du baobab sont beaucoup consommées. C’est pourquoi, à cause de l’importance de cet arbre, le propriétaire d’une parcelle de terrain, avec même un seul pied de baobab, n’accepterait jamais de la vendre, que ce soit une transaction en droit coutumier ou non. L’essence restera au compte de sa famille qui l’exploitera à sa guise.
pourquoi, à cause de l’importance de cet arbre, le propriétaire d’une parcelle de terrain, avec même un seul pied de baobab, n’accepterait jamais de la vendre, que ce soit une transaction en droit coutumier ou non. L’essence restera au compte de sa famille qui l’exploitera à sa guise.
« Le jour où le propriétaire d’un terrain où se trouvent des baobabs décide de le vendre, forcément, les arbres feront partie de la transaction », estime, pour sa part Fousseiny Sissoko, un conseiller au chef de village, qui trouve absurde le contraire.
Mahéta Sacko est imam à Diéma. Il soutient que tout est une question d’accord et de consensus. « Si celui qui vend sa parcelle de terrain, avec un ou plusieurs pieds de baobab, accepte de céder à l’acheteur ses arbres, il n’y aucun inconvénient. Il faut faire en sorte qu’aucune des deux parties ne soit lésée lors de la transaction :, explique-t-il. « L’Islam est bâti sur la paix et la cohésion sociale », commente le religieux.
Selon Aïssata Konté, domiciliée à Diéma, « le baobab appartient surtout aux femmes. On en trouve généralement dans chaque maison. Les feuilles du baobab jouent un rôle important dans l’économie familiale car elles permettent de réduire parfois les dépenses des hommes. »
« Pendant l’hivernage, on prépare souvent pour les cultivateurs de la boisson à base de poudre de pain de singe associée à la pâte d’arachide avec un peu de sucre. Une fois qu’ils consomment ce mélange, ils retrouvent la force et le courage et travaillent à cœur joie. C’est une boisson qui permet d’atténuer les effets des rayons solaires, si bien qu’à la fin de la journée, les travailleurs sentent moins de fatigue », révèle Aïssata.
 La présidente de l’Association de santé communautaire (ASACO) de Fassoudébé, Coumba Dia, affirme que dans leur village, les femmes plantent leurs propres pieds de baobabs dans leurs périmètres maraichers et les entretiennent comme les autres arbres fruitiers. Elles utilisent uniquement les feuilles de baobab et s’intéressent moins aux fruits. La dame poursuit : « Ce sont nos voisins maures qui en tirent le plus de profit. Ils font la cueillette du pain de singe et confectionnent des cordes avec les écorces qu’ils commercialisent. »
La présidente de l’Association de santé communautaire (ASACO) de Fassoudébé, Coumba Dia, affirme que dans leur village, les femmes plantent leurs propres pieds de baobabs dans leurs périmètres maraichers et les entretiennent comme les autres arbres fruitiers. Elles utilisent uniquement les feuilles de baobab et s’intéressent moins aux fruits. La dame poursuit : « Ce sont nos voisins maures qui en tirent le plus de profit. Ils font la cueillette du pain de singe et confectionnent des cordes avec les écorces qu’ils commercialisent. »
Seibane Dicko, un maure habitant à Dabaye-Laklal, entretient quotidiennement le jeune pied de baobab qui se trouve devant sa case. Il empêche les animaux de l’effeuiller, lorsqu’ils se rendent aux pâturages ou en reviennent.
Oumar Cissé est bourrelier. Superstitieux, il déclare que le baobab est un arbre qui porte-malheur. « La présence de cet arbre, dans une maison, dit-il, attire la détresse sur ses occupants ». Un homme aurait été obligé d’abandonner la maison qu’il louait, à cause d’un incendie survenu à plusieurs reprises. L’infortuné a vite fait de lier les sinistres à répétition à la présence dans la maison d’un grand baobab, vieux de près d’un siècle.
Cet engouement des femmes pour le baobab contribuera à mieux sauvegarder cette espèce en voie de disparition. Une disposition sur laquelle l’Etat et ses partenaires peuvent miser pour soutenir davantage de projets de reboisement dans cette partie de la bande sahélienne, en proie à la désertification et l’avancée du désert.
OB/MD (AMAP)