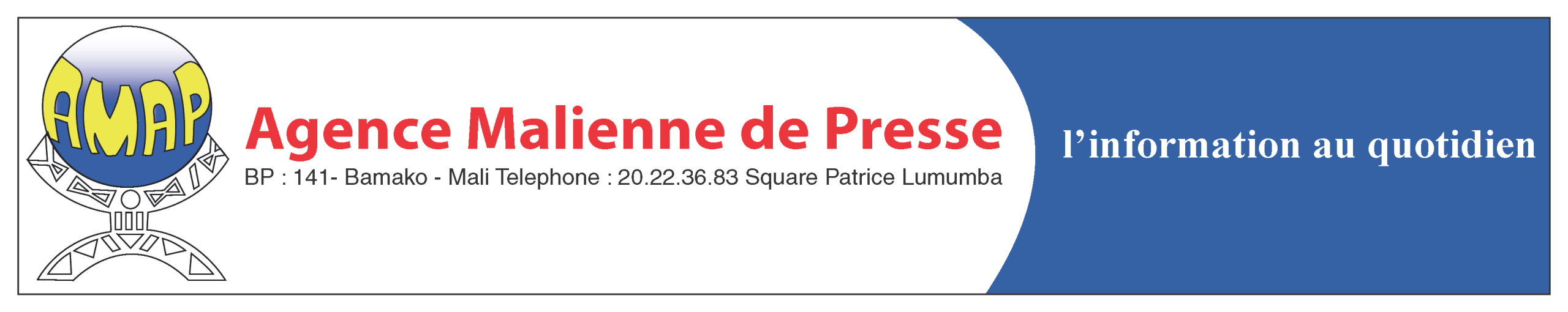Par Demba GAKOU
Par Demba GAKOU
Macina, 8 nov (AMAP) La pêche occupe une place de choix dans l’économie de la commune de Macina (Centre) et mobilise beaucoup de personnes dont les Bozos kelingas et autres personnes venant d’ailleurs pour la circonstance. Ils sont des centaines à exercer cette activité et beaucoup se sont installés le long du fleuve Niger sur près de 2km, chacun avec sa pirogue munie de moteur.
Fin octobre c’est la décrue et les pêcheurs s’en réjouissent, la pêche a commencé.
En cette période, le long du fleuve est très animée. Des piroguiers s’en vont à la pêche, d’autres en reviennent, Des femmes, des enfants ramassent le poisson de différentes variétés dont les sardinelles, les carpes, les silures…
Ces pêcheurs, qu’ils soient Bozos kelingas ou autres, pour la plupart, ont appris le métier de père en fils, « dans la famille », comme l’explique Adama Keita. Il est né « dans la pêche », celle de son époque « est différente » de celle d’aujourd‘hui.
TEMPS ANCIEN, TEMPS PRESENT – « Autrefois, les pêcheurs se contentaient d’une petite pirogue munie de perche et de pagaie pour pêcher. Les outils de pêche ne coûtaient pas aussi chers. Il n’y avait pas de surpeuplement de pêcheurs », se remémore-t-il. « Après deux ou trois mois ici, on pouvait aller dans le Massina profond pour y passer trois à quatre mois. Là, profitant du séjour, on avait l’opportunité d’amasser une importante réserve de poissons que l’on pouvait conserver et qui était destinée à la commercialisation », se souvient notre interlocuteur, un brin nostalgique.
Aujourd’hui ce temps est révolu, « la pêche se fait sur de grandes pirogues poussées de puissants moteurs. Le matériel de pêche coûte les yeux de la tête. Ne parlons pas du carburant, aujourd’hui introuvable ». « A cause de l’insécurité, on ne peut plus rejoindre les coins reculés. Les Bozos traversent des moments difficiles. Ils ne sont pas prêts à dire combien ils gagnent exactement par jour., se contentant de lâcher : « Les prises varient et dépendent de beaucoup de facteurs. »
DIVISION DU TRAVAIL – La conservation pour la commercialisation est, aussi, l’affaire des pêcheurs qui utilisent les techniques du séchage, du fumage, du brûlis et de congélation avec une unité de production de barres de glace installée sur place. Point de magasins de stockage. Juste un hangar moderne. La commercialisation passe par les mareyeurs venus de Ségou, Bamako où d’ailleurs.
La pêche est autorisée à tout détenteur de permis de pêche délivré par le chef service local de la pêche. Le permis, s’il est de catégorie A, concerne les grands filets de barrage et coûte 15 000 Fcfa, La catégorie B concerne les éperviers, les filets maillants dérivant et dormants. La catégorie C, les nasses appâtées et les filets à deux mains 3 000f Fcfa. Quant à la catégorie D, ce sont les permis sportifs pour ceux qui pêchent à la ligne pour 1 500 Fcfa.
Tout contrevenant s’exposerait à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
 PERCEE DE LA PISCICULTURE – Avec la rareté du poisson, consécutive au changement climatique, les services techniques en charge de la pêche, en partenariat avec le Programme d’appui aux collectivités territoriales (PACT), ont initié la pisciculture qui consiste à élever les poissons dans un espace contrôlé. Pour sa réussite dans les étangs et les cages flottantes, d’après un praticien, « il faut tenir compte de l’aliment poisson de qualité qui coûte cher, choisir les alevins de qualité à partir de la production artificielle surtout pour les clarias. »
PERCEE DE LA PISCICULTURE – Avec la rareté du poisson, consécutive au changement climatique, les services techniques en charge de la pêche, en partenariat avec le Programme d’appui aux collectivités territoriales (PACT), ont initié la pisciculture qui consiste à élever les poissons dans un espace contrôlé. Pour sa réussite dans les étangs et les cages flottantes, d’après un praticien, « il faut tenir compte de l’aliment poisson de qualité qui coûte cher, choisir les alevins de qualité à partir de la production artificielle surtout pour les clarias. »
La pisciculture, depuis plus d’une décennie, a fait de grands pas dans la filière pêche, à Macina. La Coopérative des pisciculteurs de Macina dont le bureau est installé depuis 2007 est présidée par le vieux Kokè Haidara,
La pisciculture, en dépit de ses exigences est plus rentable que la pêche traditionnelle, d’après un praticien
De février à mars, la pêche collective appelée «Yaya » qui remonte loin dans l’histoire de la contrée occupe tous les pêcheurs, qu’ils soient de Macina où d’ailleurs. Elle peut durer un à deux mois et commence à Myon, village à l’ouest de Kolongotomo jusqu’à Komara, dernier village à l’est de Macina. Ces mares, regorgent de poissons en quantité et en qualité.
Après la crue, la pêche se poursuit dans les retenues d’eau, les mares, les canaux d’irrigation de l’Office du Niger mais les prises sont faibles. A côté de la pêche certains pêcheurs font de la riziculture, d’autres de petits métiers, du commerce.
DM/MD (AMAP)