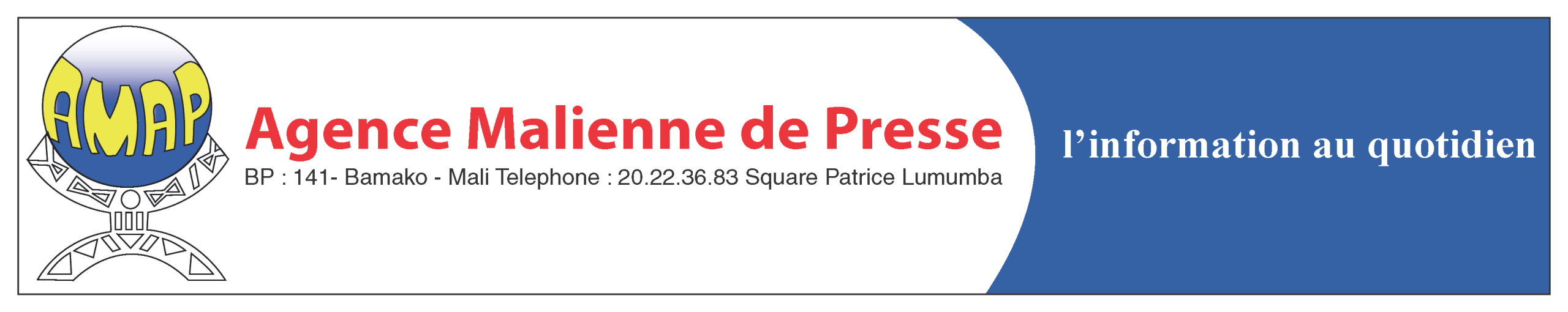Par Moussa M. DEMBELE
Par Moussa M. DEMBELE
Envoyé spécial
Bamako, 15 oct (AMAP) Le trajet Bamako-Zantiguila prend plus d’une heure. Les bus, assurant la liaison entre la capitale et Ségou (Centre) ou d’autres localités dans cette partie centrale et septentrionale du Mali, ne respectent pas toujours le code de la route. Dépassements dans les virages, notamment au niveau de la forêt classée de Zantiguila, vitesse extrême… sont fréquents,
Ce jeudi 21 août, ce n’est pas une odyssée matinale mais, un court voyage. En cette saison d’hivernage, la nature est splendide. La chaleur moins accablante. Le soleil plus doux quand notre équipe de reportage s’est rendue à Sougoubougou, un hameau situé du village de Korokoro, Commune de Zan Coulibaly, Cercle de Fana. Les fortes pluies enregistrées début août ont rendu les pistes difficilement praticables.
À moins de 200 mètres, nous rencontrons un groupe de jeunes cultivateurs dans un champ de sorgho. Cette année, les céréales se portent bien. Le seul champ de coton visible dans les environs progresse lentement. Ils sont au total 19 gaillards engagés et motivés. L’ambiance est conviviale, empreinte de joie et d’esprit d’équipe. Depuis 6 heures du matin, ils travaillent dans le champ de Balla Coulibaly. Âgés de 16 à 29 ans, les jeunes sont dirigés par Moussa Coulibaly, le plus âgé.
Ce travail collectif, transmis de génération en génération, vise à s’entraider pendant l’hivernage. La prestation coûte 10 000 Fcfa par jour. La recette des travaux est destinée à financer les festivités du 22 septembre qui marquent aussi la fin des travaux champêtres. C’est ainsi que les ressortissants de Sougoubougou commémorent l’indépendance. La solidarité pour une célébration grandiose du 22 septembre, fête de l’indépendance du Mali !
En début d’hivernage, la liste des travaux est établie, afin de tirer au sort les bénéficiaires qui recevront le groupe dans leur exploitation, l’une après l’autre. Cette année, ce sont 14 familles, qui figurent sur la liste. Ce jeudi marque la septième intervention pour une recette (à mi-chemin) de 70 000 Fcfa. C’est le propriétaire du champ, qui offre les deux repas de la journée (petit-déjeuner et déjeuner des travailleurs). Vêtu d’un pantalon coupé au genou et d’un t-shirt marron, Moussa Coulibaly, chef du groupe, âgé de 29 ans, explique les règles du jeu. « Depuis 6 heures, nous sommes ici. Celui qui ne respecte pas cet horaire est sanctionné. Il doit offrir des bonbons au groupe », dit-il, la daba sur l’épaule, avant d’ordonner à son équipe d’aller prendre le petit-déjeuner.
équipe d’aller prendre le petit-déjeuner.
M. Coulibaly ajoute qu’ils ont hérité ce travail de leurs aînés. « Aujourd’hui, c’est notre tour de respecter la tradition. Nous travaillons pour 10 000 Fcfa par jour, pour les ressortissants du village. Ceux qui sont d’ailleurs, qui nous sollicitent, doivent payer entre 40 000 et 50 000 Fcfa par jour », affirme-t-il.
Le village compte deux groupes de jeunes : ceux de 16 à 30 ans, et ceux de moins de 16 ans. La nuit du 22 septembre, chaque clan célèbre à sa manière. Trois jours de festivités et de partage.
Tongasse Coulibaly, membre du groupe, âgé de plus de 20 ans, explique que l’initiative vise à s’entraider pendant l’hivernage mais, aussi, à renforcer la cohésion et la paix entre les jeunes dans le village. Il précise que derrière cette idée, il y a la célébration de l’indépendance du Mali, « une date inoubliable pour tout Malien. »
N’tchi Coulibaly, 25 ans, souligne l’importance de leurs interventions pendant l’hivernage. « À chaque passage chez quelqu’un, nous finissons par cultiver ses champs. Le paiement est symbolique. Ce qui compte, c’est le travail », précise-t-il.
 Après les travaux collectifs, c’est tout le village qui est mobilisé pour célébrer le 22 septembre. « Et le jour de la fête, c’est la joie totale dans tout le village. Dans l’avenir, nous espérons qu’une ONG pourra nous soutenir dans d’autres projets », dit-il, insistant sur l’union de leur groupe.
Après les travaux collectifs, c’est tout le village qui est mobilisé pour célébrer le 22 septembre. « Et le jour de la fête, c’est la joie totale dans tout le village. Dans l’avenir, nous espérons qu’une ONG pourra nous soutenir dans d’autres projets », dit-il, insistant sur l’union de leur groupe.
Au départ, c’était des activités collectives organisées entre les membres du petit groupe de maisons. Une compétition entre les jeunes, était organisée dans le but de prouver leur bravoure dans les champs. Chaque génération formait un groupe. L’objectif était de développer le village et unir ses ressortissants. « Nous avons toujours voulu organiser des fêtes à la fin de nos travaux champêtres. Avant, ce n’était pas le 22 septembre mais, plutôt, la fête de nos instruments de musique traditionnels. Tout le monde se retrouvait à la place du village pour célébrer la fin de l’hivernage », a rappelé, Djamako Coulibaly, chef du hameau de Sougoubougou, âgé plus de 80 ans.
Aux premiers jours de l’indépendance, le 22 septembre était célébré dans les chefs-lieux. C’était une grande rencontre culturelle pour commémorer cette date historique. Chaque village montrait son savoir-faire. « Nous fêtions le 22 septembre à Fana. C’était sur l’invitation du commandant. Chaque village apportait ses instruments de musique. Des concours de danse, de course de vélos, des matchs de football étaient organisés. C’est un rendez-vous exceptionnel entre tous les habitants du cercle », se souvient Djamako Coulibaly.
Au fil du temps, la célébration a pris une autre forme. Plus de rencontre au chef-lieu d’arrondissement. Chaque localité célèbre en sa manière. Si d’autres font des cotisations, la population de Sougoubougou a opté pour des travaux champêtres collectifs. « Ce sont les jeunes qui ont eu l’idée de mettre en place cette activité collective. À la fin des travaux, c’est la fête du 22 septembre. Et je trouve que l’initiative est bonne parce qu’elle permet de renforcer les liens sociaux », se réjouit Zan Coulibaly, 60 ans révolus.
Aujourd’hui, beaucoup estiment que l’idée mérite un soutien pour sa pérennisation. Demba Coulibaly, âgé de 46 ans, constate qu’avec son époque, il y a une différence, non seulement au niveau du travail mais, aussi, dans la célébration d’hier et aujourd’hui. « L’idée de cohésion demeure toujours, sinon des jeunes d’aujourd’hui fournissent peu d’efforts dans les champs. Même pour la célébration, ils n’impliquent pas assez les personnes âgées comme nous le faisions », conclut-t-il.
MMD/MD (AMAP)