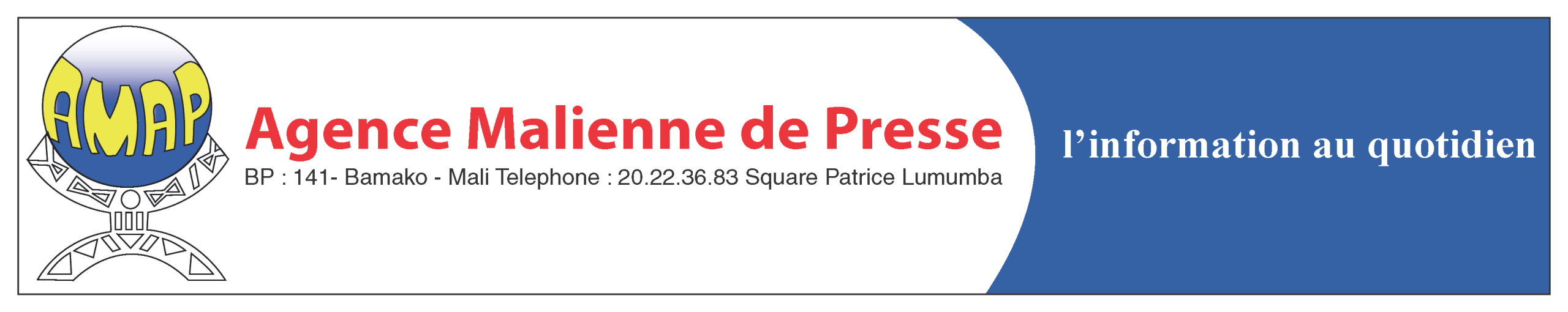Bourama Soumano, griot : « La crise des griots s’inscrit dans un effritement général des repères sociaux »
Par Moussa M. DEMBELE
À Bamako, comme dans beaucoup de villes de pays de cette tradition, en Afrique de l’Ouest, les griots, jadis mémoire collective et acteurs de médiation sociale, connaissent une mutation. Si certains continuent d’incarner la tradition, d’autres sont accusés d’avoir troqué leur rôle de conciliateur par appât du gain.
Bamako, 14 juil (AMAP) La transmission orale, socle des sociétés africaines, a longtemps été assurée par les griots, dépositaires de l’histoire, des généalogies et de la parole sacrée. De génération en génération, ils ont su préserver les savoirs, jouer les médiateurs et animer la vie communautaire. Mais, aujourd’hui, certains estiment qu’ils ont délaissé leur mission au profit d’un confort personnel.
Ce dimanche 18 mai, à Bamako, comme le chantait le duo du défunt Amadou et son veuve Mariam, « c’est le jour des mariages ». Au centre-ville, les cortèges s’enchaînent. Dans un quartier périphérique, l’arrivée d’un couple fraîchement marié attire les regards. La mariée, en robe blanche, est accompagnée d’un époux en boubou blanc. À leurs côtés, une griotte micro en main s’adresse au père de la jeune femme : « Les griots de Bamako ont faim. Nous demandons aux nobles hommes de nous donner à manger. Coulibaly, sois fier, car tout le monde n’a pas la chance de marier sa fille ».
Un vieux griot renchérit, en s’égosillant : « C’est le respect de la parole donnée qui fait la différence entre les hommes. Et tu as toujours tenu tes promesses. Tu es un homme digne. Nous sommes tous ici pour l’argent. »
DEVOIR MORAL OU QUETE D’ARGENT – Ce genre de discours agace certains observateurs. Pour Salimata Fomba, femme au foyer, les griots ont délaissé leur vocation. « Aujourd’hui, ils ne s’intéressent qu’aux personnes riches. Lors des mariages, j’ai peur qu’un griot parle de moi. Ils poussent les gens à aller au-delà de leurs moyens. Si vous ne casquez pas, vous n’aurez pas droit à des éloges », se désole-t-elle.
Même constat chez Issiaka Dembélé, qui lie l’augmentation des divorces au changement des griots dans leur rôle traditionnel. « Avant, ils intervenaient pour réconcilier les époux. Aujourd’hui, ils ne sont présents que dans les cérémonies festives », dit-il.
Adama Diabaté, griot à Bamako, se défend : « Nous n’avons pas d’autres métiers. J’informe les gens des cérémonies mais, souvent, je ne reçois rien. Nous méritons une récompense. »
Le statut de griot ne s’acquiert pas, il se transmet. « On ne devient pas griot, on naît griot. Ce n’est pas une ethnie, mais une fonction héréditaire », explique Bourama Soumano. Il avance que la crise des griots s’inscrit dans un effritement général des repères sociaux. « Ce n’est pas que les griots qui ont failli. Les notables et les autorités aussi. Autrefois, notre parole était écoutée. Aujourd’hui, elle ne compte plus », regrette-t-il.
fonction héréditaire », explique Bourama Soumano. Il avance que la crise des griots s’inscrit dans un effritement général des repères sociaux. « Ce n’est pas que les griots qui ont failli. Les notables et les autorités aussi. Autrefois, notre parole était écoutée. Aujourd’hui, elle ne compte plus », regrette-t-il.
Autre facteur de cette mutation est l’absence de cadre juridique. « L’État n’a prévu aucune loi reconnaissant notre rôle. Jadis, nous étions conseillers, éducateurs, animateurs. Toutes ces fonctions nous ont été arrachées », déplore Djeli Soumano.
Dr El Hadji Ousmane Boré, historien à la Faculté d’histoire et géographie de Bamako, rappelle le rôle central des griots dans les sociétés anciennes. « Ils servaient de contre-pouvoir dans les régimes monarchiques. Un roi pouvait tout décider mais, seul le griot pouvait le faire réfléchir en invoquant ses ancêtres », argumente-t-il. Mais le professeur note une dérive : « Aujourd’hui, qui sont les vrais griots ? L’argent a tout corrompu. Ce métier noble est devenu une activité mercantile. »
Pour lui, une solution existe. « Il faut créer une école pour griots, avec des formations en éthique, histoire et communication. Des associations existent mais, il faut une volonté politique pour encadrer cette pratique », propose-t-il.
Kemoko Diabaté, étudiant -journaliste passionné d’histoire des griots et grio de naissance lui-même, déplore qu’autrefois, les griots ne mendiaient pas. « Ils avaient un vrai pouvoir : celui de la parole. Aujourd’hui, certains suivent les mariages dans la rue, demandent le nom des gens et improvisent des louanges. Ce n’est pas cela un griot », explique-t-il.
Il retrace le déclin de la fonction, amorcé, selon lui, au XVIIe siècle. « Avec l’arrivée des colons et la disparition des souverains, les griots ont perdu leur place. Ils sont devenus tailleurs, commerçants ou griots ambulants », ajoute-t-il. Ajoutant que l’introduction de la guitare a transformé leur art. L’oralité est devenue un moyen de survie. « Aujourd’hui, rares sont ceux qui perpétuent les vraies valeurs », conclu-t-il.
MMD/MD (AMAP)