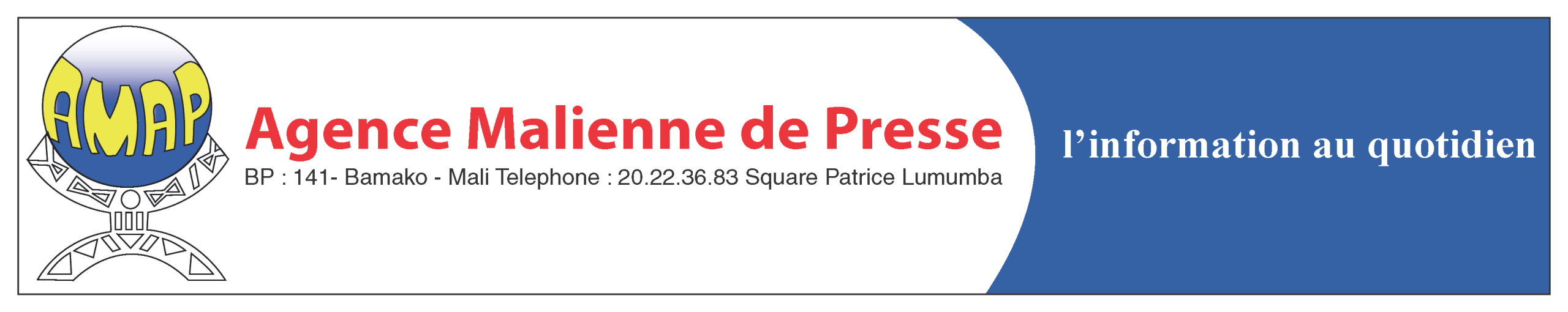Par Mamadou SY
Par Mamadou SY
Ségou, 18 mai (AMAP) Face à la baisse de la quantité de poissons pêchés dans les lacs, fleuves et barrages, de plus en plus de personnes s’investissent dans la pisciculture afin de répondre à la forte demande des consommateurs. À Ségou, la pisciculture portée par des particuliers connaît un essor prometteur. Levier essentiel de création d’emplois et de développement, ce secteur suscite l’espoir d’une autosuffisance en protéines animales. Cependant, malgré ses atouts, cette activité qui se pratique en milieu naturel ou avec un bassin artificiel se heurte à plusieurs contraintes.
Issu de la toute première promotion de l’Université de Ségou en agroéconomie, Mamoutou dit Djamba Sissoko est le promoteur de «Kanyela-Agri». Cette entreprise évolue dans la pisciculture et le maraîchage depuis 2020. Nous l’avons rencontré en ce mercredi 7 mai en plein travail sur son champ situé au quartier Angoulême. C’est avec beaucoup de passion que Mamoutou Sissoko s’investit dans cette activité rythmée au quotidien par l’alimentation de ses poissons, le contrôle de la qualité de l’eau ainsi que l’entretien des cultures maraîchères. D’un seul bac hors sol au départ, il en compte aujourd’hui 4, grâce au soutien du projet «Jègè ni Jaba» et 2 étangs piscicoles contenant 600 tilapias et 500 clarias.
Le jeune Sissoko met en valeur les déchets organiques produits par les poissons pour fertiliser ses plantes et parvient à tirer son épingle du jeu dans cette activité en générant un chiffre d’affaires d’au moins 500.000 Fcfa avec ses 4 bacs hors sol. Cependant, souligne-t-il, l’envolée des prix des aliments poissons constitue une contrainte majeure pour bon nombre de pisciculteurs. À titre d’illustration, il évoque le sac de 20 kg qui coûte actuellement 28.000 Fcfa contre 16.000 Fca et 40.000 Fcfa pour certaines variétés. Le fondateur de «Kanyela-Agri» estime qu’avec ses 4 bacs hors sol, il doit acheter chaque semaine au moins 20 kg d’aliments pour nourrir ses poissons et cela ne représente que le minimum nécessaire.
Notre jeune entrepreneur déplore le fait que les aliments produits localement ne sont pas suffisamment riches pour permettre une bonne croissance des poissons qui atteignent à peine 700 g en 6 mois. En revanche, dira-t-il, avec des aliments importés, on peut obtenir des poissons de plus de 1 kg en 4 mois. Mamoutou Sissoko lance un appel à l’État et à ses partenaires afin de mettre en place une usine de production d’aliments de poissons de qualité, avant de prôner une meilleure structuration des acteurs concernés et une qualité optimale des intrants subventionnés.
Évoluant dans la production d’alevins et le grossissement de poissons, la ferme piscicole «Kosso» de Madou Diarra (31 ans), propose des services de formation et d’accompagnement aux pisciculteurs. Après l’obtention de son baccalauréat, Madou Diarra réussit le concours d’entrée au Centre de formation pratique en aquaculture de Molodo. Deux ans plus tard, il en sort diplômé en tant qu’agent technique. Après un passage à l’Institut d’économie rurale (IER) de Mopti en tant que superviseur de souches, il décide de lancer sa propre entreprise en 2021.
«Avec la disparition de certaines espèces de poissons, il y a un véritable engouement pour la pisciculture. Nombreuses sont les personnes qui souhaitent se lancer dans ce secteur», note Madou Diarra. Pour les soutenir, une formation sur les fondamentaux de la pisciculture a été développée au sein de sa ferme. Elle attire des participants aux profils variés, avec une forte présence des jeunes.
D’après notre interlocuteur, la pisciculture permet de consommer directement ce que l’on produit, tout en réduisant les importations de poissons. Le responsable de la ferme piscicole «Kosso», souligne qu’avec seulement 300.000 Fcfa, on peut démarrer la pisciculture à petite échelle. Ce budget permet d’acquérir un bac hors sol de 1 m3, 105 alevins, ainsi que plusieurs sacs d’aliments. Madou Diarra déplore le fait que les aliments importés restent coûteux et l’absence de spécialistes qualifiés en pathologie piscicole. À l’avenir, il souhaite que les consommateurs privilégient la production nationale, et que les pisciculteurs puissent répondre à la demande des consommateurs.
Mahamadou Kané, un autre pisciculteur ambitionne de réduire la problématique de l’accès à des intrants piscicoles à travers une production d’alevins de qualité en quantité suffisante et à des prix abordables. L’objectif est de permettre aux acteurs d’accroître leur production. Tirant cette passion de son père, Mahamadou Kané produit aussi des aliments flottants. Avec près de 20 ans d’expériences dans le secteur, la ferme familiale située à Banankoro, s’étend sur 5 hectares. Elle comprend un étang, 16 bassins et une écloserie d’une capacité de production de 100.000 alevins clarias par an. Ce n’est pas tout, le riz est produit sur place, et l’eau provenant de la pisciculture est réutilisée pour irriguer les champs. Des agrumes, melons et pastèques y poussent à profusion.
Même si la pisciculture n’a pas autant de notoriété que l’aviculture, elle reste une activité très lucrative. Mahamadou Kané a révélé qu’en plus de disposer de la souche adéquate, le Mali possède un nombre important d’écloseries pour la production d’alevins, ainsi que des producteurs d’intrants piscicoles et d’aliments pour poissons.
Autant d’atouts que l’État, avec l’appui de ses partenaires, doit saisir pour encourager les citoyens à se tourner vers la pisciculture qui est non seulement une activité rentable, mais aussi un levier de développement.
MS/MD (AMAP)
Baréma Koïta, chef du secteur pêche de Ségou : «Il faut favoriser l’accès aux intrants de qualité à un prix raisonnable»
Par Mamadou SY
Ségou, 18 mai (AMAP) Le service de la pêche a pour rôle l’appui conseil, et le contrôle de la réglementation en vigueur. Selon Baréma Koïta, chef du secteur pêche de Ségou, la pisciculture en tant que technique d’élevage de poisson a vu le jour au Mali par l’initiation d’une petite station piscicole expérimentale dans la Région de San. La convention de financement l’instituant a été signée en novembre 1979 entre le gouvernement de notre pays et celui des États-Unis avec l’appui de l’USAID. C’est ainsi qu’une antenne de vulgarisation a été créée à Niono, dans la zone Office du Niger, en raison de la disponibilité en eau et des sous-produits agroalimentaires. Depuis, une multitude de techniques dont la rizipisciculture et la pisciculture en cage ont été testées et adaptées en milieu rural, a-t-il rappelé.
Concernant les infrastructures piscicoles, le Cercle de Ségou compte actuellement 131 étangs et 115 bacs hors sol et 2 cages flottantes. La rizipisciculture combinant la culture du riz et l’élevage de poissons, couvre une superficie de 7.500 m2, tandis que les mares sont au nombre de 31 et s’étendent sur 51,68 hectares, a détaillé Baréma Koïta. Les performances enregistrées ces dernières années se situent au niveau des cages flottantes et bacs hors sols. Pour une cage flottante de 144 m3 la production obtenue a été de 2.624 kg pour 10.000 alevins. Quant au bac hors sol de 10 m3 avec 1.000 poissons, il a permis de récolter 369 kg, a souligné le chef du secteur pêche de Ségou.
Les tilapias nilotica (Ntèbèfing) et les clarias gariepinus (Manogo) sont les deux espèces ayant fait l’objet d’études positives en ce qui concerne la pisciculture dans notre pays. Parmi les initiatives en cours pour soutenir la pisciculture à Ségou, figurent le Projet de restauration des terres dégradées (PRTD), celui de l’appui à l’amélioration des moyens d’existence durable d’atténuation et d’adaptation des communautés de pêche face aux changements climatiques et Jègè ni Jaba (JNJ), a fait savoir Baréma Koïta.
S’exprimant sur les difficultés, le chef du secteur pêche de Ségou dira que l’acquisition des intrants par les producteurs demeure une préoccupation. En outre, sa structure ne compte pas suffisamment d’agents pour couvrir tout le cercle et l’accès à certaines localités est entravé par l’insécurité grandissante. Le service de la pêche de Ségou fait également face à une insuffisance de moyen financier. Baréma Koïta pense que pour tirer profit de la pisciculture, il faut « favoriser l’accès aux intrants de qualité à un prix raisonnable, disposer d’une source d’eau permanente, suivre régulièrement l’entretien des infrastructures et sécuriser le dispositif contre le vol». Parlant des défis et perspectives, il a évoqué la réduction du coût des intrants, l’aménagement des infrastructures piscicoles et le renforcement des capacités des producteurs.
MS/Md (AMAP)