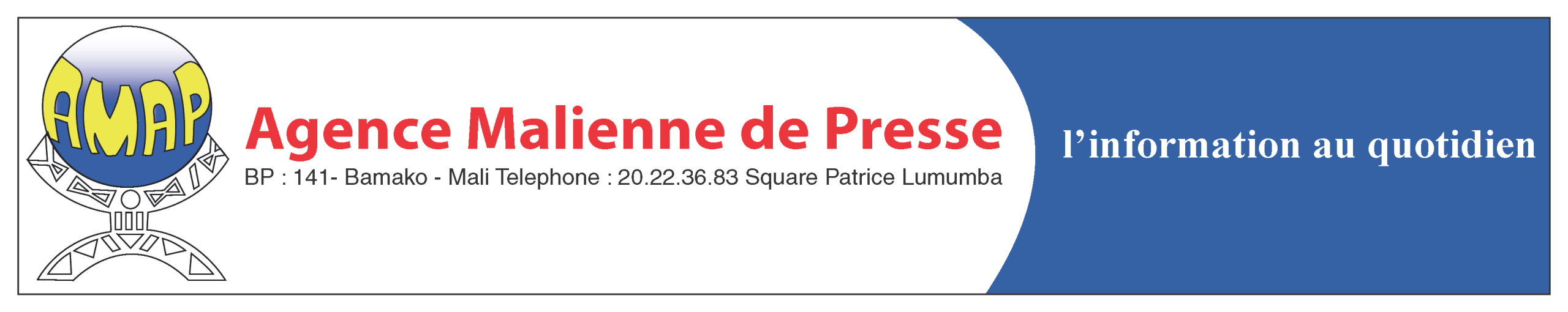Par Aminata Dindi SISSOKO
Par Aminata Dindi SISSOKO
Ségou, 18 mai (AMAP) Aliment de base incontournable, notamment en milieu urbain, le riz occupe une place prépondérante dans le régime alimentaire des Maliens. Il contribue à hauteur de 31 pour cent à la production nationale de céréales et représente environ hauteur de 5 % au produit intérieur brut (PIB) du pays. Le Mali se positionne, d’ailleurs, parmi les principaux producteurs de riz en Afrique.
Pour la campagne 2023-2024, la production nationale est estimée à 3 024 000 tonnes, en légère progression par rapport aux 2 900 000 tonnes de la campagne précédente. Toutefois, en dépit de ce potentiel important et des efforts déployés, soutenus par l’engagement manifeste des plus hautes autorités, le pays continue d’importer une part significative du riz destiné à la consommation intérieure. Cette situation accentue le déséquilibre chronique de la balance commerciale.
Face à cette dépendance préoccupante, le Système de riziculture intensive (SRI) se présente comme une alternative prometteuse. Cette approche innovante permettrait non seulement d’accroître les rendements du riz localement produit, mais également de réduire la dépendance aux importations.
Conçu à Madagascar dans les années 1980, le SRI vise à améliorer la productivité par des changements dans les pratiques culturales plutôt que par une augmentation des intrants. Il repose notamment sur le repiquage de jeunes plants âgés de 8 à 10 jours, plantés individuellement avec un espacement large, une gestion parcimonieuse de l’eau, une aération régulière du sol par le désherbage mécanique et l’utilisation d’engrais organiques.
Introduit au Mali en 2007 dans la région de Tombouctou par l’ONG Africare, le SRI a, par la suite, été étendu aux régions de Gao, Mopti (en zone maîtrisée), Sikasso (en zone pluviale), Ségou et Kayes.
Cependant, malgré ses multiples bénéfices économiques, sociaux environnementaux les superficies cultivées selon cette méthode représentent à peine 2% des superficies rizicoles emblavées à l’échelle nationale, dans le cadre du Programme national de mise à l’échelle du SRI (PN-SRI), selon les statistiques présentée par le Mali lors du Forum régional sur la transformation des systèmes agricoles vers des modèles durables.
Dans la région de Ségou (Centre), l’Office du Niger (ON) présente un potentiel important pour le SRI. Depuis 2017, cette méthode agricole est testée dans les sept zones de production de l’ON. D’année en année, l’Office est en train de multiplier les initiatives en vue d’une adoption à grande échelle. Auguste Drago, directeur de l’appui au monde rural de l’ON, indique que pour la campagne 2024-2025, 163 parcelles de démonstration ou champs écoles ont été mises en place, couvrant une superficie totale de 163 hectares.
Au sein de ces parcelles, 2 735 producteurs ont été formés aux techniques du SRI, dont 1 500 l’ont effectivement adopté, soit un taux d’adoption de 55 %. Un chiffre significatif, que le directeur attribue à l’enthousiasme croissant des producteurs, stimulé par des campagnes de sensibilisation, des formations ciblées, l’implication des radios de proximité, ainsi que l’efficacité des démonstrations sur le terrain.
Pour la campagne 2025-2026, l’ON prévoit de poursuivre ses efforts avec 137 nouvelles parcelles de démonstration, sur une superficie prévue de 229,15 hectares. L’objectif est de former 3 170 producteurs supplémentaires au SRI.
L’Office Riz Ségou (ORS), dont l’expertise en matière de riziculture n’est plus à démontrer, expérimente le Système de Riziculture Intensive (SRI) depuis 2014. Cette méthode a connu un essor notable à partir de 2018 grâce au Projet Centre d’Innovations Vertes (CIV-GIZ), soutenu par la Coopération allemande.
De 2018 à 2025, le nombre total de producteurs ayant bénéficié de cette approche s’élève à 5 607, pour une superficie totale d’adoption atteignant 3 760,75 hectares. Par ailleurs, 176 Champs Écoles Paysans (CEP) ont été mis en place dans le cadre de cette initiative.
Selon le directeur de l’ORS, Amedé Kamaté le taux actuel d’adoption du SRI avoisine les 10 %. Il affirme que l’Office du Riz de Ségou demeure résolument engagé à poursuivre les actions de sensibilisation auprès des acteurs du secteur, dans le but de favoriser une adoption à grande échelle au cours des dix prochaines années.
Pour la campagne agricole 2025-2026, une superficie de 1 100 hectares est prévue pour la mise en œuvre du SRI, tandis que 1 200 hectares sont planifiés pour la campagne suivante, en 2026-2027.
Pour sa part, la cheffe de division conseil et vulgarisation agricole auprès de la directeur régionale de l’agriculture de Ségou, Dao Rokia Coulibaly rappelle que le SRI constitue l’un des axes majeurs de la stratégie de vulgarisation agricole actuelle. « La Direction nationale de l’agriculture souhaite faire un programme d’envergure, accessible à l’ensemble des producteurs. Une étude environnementale et sociale a d’ailleurs été réalisée à cet effet » a-t-elle précisé tout en soulignant que les efforts se poursuivent.
DÉFIS – Toutefois, le taux d’adoption du SRI demeure relativement faible. Les acteurs attribuent cette situation à plusieurs difficultés notamment l’insuffisance de financement de l’Etat, les défis liés à la recherche, le manque d’équipements adaptés aux différentes étapes de la culture ; l’absence de formation continue, faible disponibilité tant en quantité et qu’en qualité de fumure organique ainsi que le déficit en personnel et en moyens opérationnels au sein des structures d’encadrements. A cela s’ajoutent un déficit de sensibilisation et de communication ainsi que la pénibilité du travail notamment les opérations de repiquage qui requièrent une grande minutie.
Malgré ces nombreux défis certaines productrices et producteurs s’illustrent par leur engagement en faveur du Système de Riziculture Intensive (SRI). C’est le cas de Moussokoro Dembélé productrice de riz dans la zone de Molodo. Elle expérimente la méthode depuis 6 ans. « Depuis que j’ai adopté cette méthode de culture de riz, je ne suis plus revenue en arrière. Car elle est extrêmement rentable. J’ai commencé avec 0,20 hectare, aujourd’hui je suis à 1,20 hectare » confie-t-elle.
 Elle souligne le SRI présente de multiples tant en termes de rendement que d’économie d’eau et de semences. « les rendements sont très élevés. Depuis mes débuts, je n’ai jamais connu d’échec. La qualité du riz est telle que mes clients réservent leurs commandes avant même la récolte » affirme-t-elle avec fierté.
Elle souligne le SRI présente de multiples tant en termes de rendement que d’économie d’eau et de semences. « les rendements sont très élevés. Depuis mes débuts, je n’ai jamais connu d’échec. La qualité du riz est telle que mes clients réservent leurs commandes avant même la récolte » affirme-t-elle avec fierté.
Bakary Coulibaly qui pratique le SRI à Bewani, depuis plus d’une dizaine d’années témoignent également ses bénéfices « Certes, le travail est exigeant, mais tous les efforts fournis se traduisent par une meilleure productivité » indique-t-il. Il exploite aujourd’hui une superficie de 7 hectares et obtient un rendement moyen de plus de 6 tonnes à l’hectare.
Pour de nombreux acteurs de la filière rizicole, la mise en œuvre à grande échelle SRI pourrait constituer une solution majeure en faveur de la souveraineté alimentaire à laquelle aspire notre pays.
Faliry Boly, président de l’interprofession riz ((IFRIZ-MALI) et riziculteur à Molodo dans la zone de l’Office du Niger appelle à une appropriation résolue du SRI. « Le SRI peut grandement contribuer au développement agricole au Mali. Il permet d’améliorer la productivité : à une production initiale de trois tonnes, il est possible d’ajouter près de la moitié, soit un total dépassant les cinq tonnes. Si on parvenait à appliquer le SRI sur la moitié des superficies cultivables du pays, ce serait déjà un grand pas vers l’objectif visé » a-t-il affirmé insistant sur la nécessité d’un appui politique fort et d’une mécanisation adaptée.
De son côté, le directeur de l’Office riz Ségou, Amedé Kamaté, se dit pleinement convaincu que le SRI peut jouer un rôle déterminant dans l’atteinte de la sécurité alimentaire et de la souveraineté nationale : « Le SRI a été levier du rehaussement du rendement du riz de submersion contrôlée et de la maitrise totale avec l’atteinte des résultats de maxi de 9 T/ha par certains producteurs », affirme-t-il.
GOUVERNEMENT ENGAGÉ – Conscient de l’enjeu le gouvernement multiplie les initiatives pour répondre au défi de l’autosuffisance alimentaire avec comme objectif une augmentation significative de la production et de la productivité rizicole. Avec l’appui de ses partenaires notamment la Coopération allemande, GIZ-Mali, il a lancé le programme national de mise à échelle du système de riziculture intensif en 2020. Cette ambitieuse initiative vise à porter la production nationale de riz à 5,5 millions de tonnes d’ici 2030, tout en intégrant les préoccupations majeures telles que la préservation de l’environnement et l’amélioration des revenus des exploitants agricoles.
Un Forum national sur le financement durable du PN-SRI s’est tenu à Bamako en avril dernier, rassemblant l’ensemble des parties prenantes. A cette occasion le gouvernement a réaffirmé son engagement en annonçant une contribution à hauteur de 60 % au financement global du programme. Le coût total du PN-SRI est estimé à 14,112 milliards de francs CFA. Un autre Forum régional sur la transformation des systèmes agricoles vers des modèles durables s’est tenu 05 au 07 Mai dernier à Bamako. L’événement, axé sur le partage d’expériences, le financement et l’institutionnalisation du SRI en Afrique de l’Ouest a marqué une étape importante dans la concrétisation des ambitions nationales en matière de riziculture.
Dans le but d’assurer une mise à l’échelle du SRI dans toutes les zones de production de riz au Mali, certains experts souligne la nécessité de mettre en place un plan de financement pour faciliter l’accès à un plus grand nombre de petits producteurs aux innovations est nécessaire. D’autres suggèrent que l’Etat, les offices, agences et interprofessions participent au financement de la recherche rizicole pour lever les défis de la recherche.
ADS/MD (AMAP)