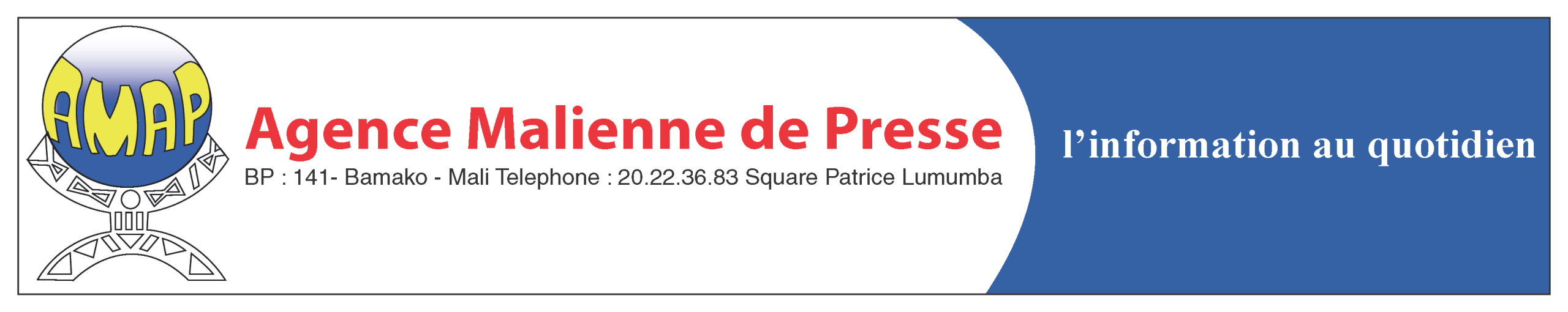Par N’Famoro KEITA
Par N’Famoro KEITA
Bamako, 15 mai (AMAP) L’an dernier, les eaux du fleuve Niger avaient débordé pour remplir les rues et les maisons de certains quartiers de Bamako et ses environs. Mais ces derniers mois, la réalité était tout autre. La tendance pourrait s’inverser avec l’hivernage qui arrive
Actuellement, le niveau des cours d’eau connaît une baisse substantielle sur toute l’étendue du territoire. Face à cette situation hydrologique, le déstockage des retenues des barrages de Sélingué-amont et de Manantali-amont se poursuit. Ces informations sont données par la Direction nationale de l’hydraulique (DNH) à travers ses bulletins hebdomadaires. La même source informe que les hauteurs d’eau observées en mi-avril sont supérieures à celles de l’année dernière. En général, le tarissement vertigineux des cours d’eau durant ces dernières années est préoccupant et alertant.
Famadi, habitant de Djicoroni-Para, en Commune IV du District de Bamako, affirme que l’assèchement du fleuve Niger dépasse son entendement. À l’en croire, cela fait deux décennies que les riverains n’ont pas constaté une telle baisse du niveau d’eau du fleuve qui traverse la capitale de long en large. Sitan, mère de 4 enfants, renchérit qu’elle est venue dans ce quartier en 2000 après son mariage, elle n’a jamais vu le fleuve Niger tarir de la sorte. Plusieurs personnes corroborent le constat de nos deux interlocuteurs.
Naturellement, la décrue des cours d’eau n’est pas un constat étonnant pendant la saison sèche. Mais quand elle s’accélère, elle peut engendrer des défis environnementaux et alimentaires. Selon les spécialistes du climat, ce phénomène est induit par le changement climatique.
Le météorologue Bakari Mangané, chargé des prévisions et alertes météorologiques à l’Agence nationale de la météorologie (Mali-météo), nous édifie sur le phénomène. Selon le spécialiste, il y a des périodes où l’écoulement est très rapide, surtout en temps de forte chaleur, où le coefficient d’infiltration est très élevé. Il ajoute que le coefficient de l’évapotranspiration provoqué par des grands vents se manifeste à la surface des cours d’eau. Le phénomène est aussi dû à l’augmentation globale mondiale de la température, ce qui favorise l’accélération de ces deux coefficients.
Il y a également des pratiques néfastes qui affectent les cours d’eau, tel que le dragage. Cette activité aurifère est en train de mettre les points d’eau en péril et la faune aquatique en danger. Pour remédier à ce problème très sérieux, Bakari Mangané pense qu’il faut communiquer et sensibiliser les populations. « Les gens doivent prendre conscience de la protection de notre environnement, veiller à la bonne santé des cours d’eau, construire des mini-barrages pour capter l’eau», soutient-il.
MISE EN VALEUR DES COURS D’EAU – Lors de la mission de supervision du plan de campagne agricole 2025 du ministre de l’Élevage et de la Pêche, Youba Ba, dans la Région de Bougouni, les éleveurs et les pêcheurs ont beaucoup sollicité la mise en valeur des cours d’eau, en créant des points de stockages du liquide précieux à travers le pays. Selon leur explication, ceci permettra d’éviter la perte de ce potentiel généré par l’hivernage et qui s’étiole considérablement pendant la saison sèche.
La stagnation des cours d’eau favorise l’agriculture, surtout les cultures maraîchères. Mais cette année, assure le directeur national adjoint de l’agriculture, les nappes souterraines ont été bien alimentées en eau suite à la bonne pluviométrie de l’hivernage passé. De ce fait, la décrue n’a pas eu d’effet négatif sur la culture de contre saison (céréales et légumes), explique Ousmane Camara. Et d’ajouter que l’abondance des eaux souterraines renforce les possibilités d’irrigation pour répondre aux besoins des cultures. Donc, la campagne de contre saison s’est déroulée dans des conditions favorables, avec une bonne disponibilité en eau qui a permis de mettre en place les cultures.
Selon le bulletin de suivi des activités de contre saison à la date du 15 avril de la DNA, les céréales ont été cultivées sur 36.960 hectares, soit 64,92% des objectifs, les cultures maraîchères ont occupé 104.098 hectares, soit 107,31% des objectifs. Ce qui explique le fait que la décrue dans les zones de culture de contre saison n’a pas affecté la campagne.
NK/MD (AMAP)