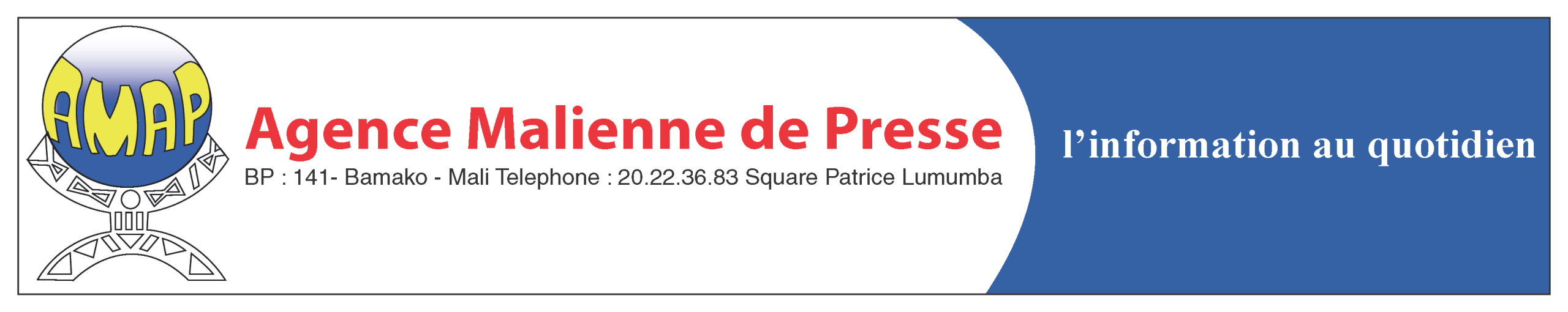Par Amadou SOW
Par Amadou SOW
Bamako, 24 oct (AMAP) «Sikasso, Kadiolo, Ségou Markala, Mopti, Douentza», hurlent de jeunes garçons devant le portail de la gare routière de Sogoniko, a Bamako, la capitale malienne. Ils invitent les éventuels voyageurs à rejoindre les cars des différentes compagnies de transport qui desservent ces localités. Ce sont des intermédiaires, appelés dans un langage argotique les «coxeurs».
Ces démarcheurs ont pignon sur rue et font la loi dans plusieurs secteurs d’activités. On les retrouve dans les locations et ventes de maisons, de terrains à usage d’habitation, de véhicules, mais aussi d’articles divers.
Le spécialiste en sociologie de la jeunesse et directeur des études de l’Institut national de la jeunesse, Dr Youssouf Karembé, explique que le phénomène existe depuis des lustres. Selon lui, les « coxeurs » se définissent comme des facilitateurs. Certaines personnes estiment que c’est une catégorie de jeunes sans formation et généralement analphabètes qui, en quête de leur pitance, interviennent dans les ventes et dans les activités de marketing pour intéresser la clientèle.
Les intermédiaires sont aujourd’hui lésion. Cette situation s’explique par le manque d’opportunités d’emplois pour les jeunes sans qualification professionnelle. En plus, ils officient dans le secteur informel avec une prédominance du sexe masculin.
Des femmes aussi jouent le même rôle dans le transport de sable ou de graviers vers les grands chantiers de construction.
Pour Dr Karembé, le fait que ces facilitateurs évoluent dans le secteur informel rend quasi impossible la collecte de statistiques fiables. Il souligne, aussi, la mauvaise réputation « à tort ou juste raison » de ceux qui évoluent dans ce segment d’activité. Certains d’entre eux développent une addiction aux stupéfiants dangereux pour la santé humaine et finissent par avoir « des comportements indignes dans l’exercice de cette profession informelle ». Aujourd’hui, de nombreuses personnes, y compris des spécialistes des questions de jeunesse et d’autres acteurs intervenant dans l’éducation des jeunes, s’accordent sur « la nécessité d’une organisation de ce métier, au moins l’encadrer pour permettre à certains d’exprimer leur talent de fin négociateur. »
Notre équipe de reportage a sillonné quelques gares routières de Bamako à la rencontre de coxeurs. Sur notre insistance sous une pluie fine, Moussa Coulibaly, intermédiaire dans une gare routière de la capitale accepte de parler de son travail. «Je pratique ce métier depuis 7 ans. Avant, j’étais jardinier dans le champ d’un haut fonctionnaire sur la route de Kangaba. Après y avoir passé quelques temps, je me suis reconverti coxeur», explique le garçon qui semble sous l’effet d’un psychotrope. Et de poursuivre : «Nous sommes parfois chassés par la police lors des patrouilles. »
TAUX FORFAITAIRE – Il explique être à la cherche de la somme nécessaire à l’établissement de son permis de conduire. Selon lui, une fois qu’il obtiendra le permis de conduire, il abandonnera ce travail informel. Son coéquipier Oumar Konaré soutient que c’est une période de vaches maigres pour eux. La crise multiforme que vit le Mali est passée par là. Il explique que de nombreux « coxeurs » cherchent aussi à se caser comme vigiles, notamment devant les maquis.
Par contre, le gestionnaire d’une grande compagnie de transport, sous anonymat, explique clairement que la collaboration avec ces jeunes ne lui a jamais traversé l’esprit. Mamadi Sidibé, chauffeur de bus, reconnaît que ces intermédiaires travaillent avec d’autres transporteurs. Ils ont un taux forfaitaire en fonction de la destination. Par exemple sur 30.000 Fcfa, le « coxeur » gagne entre 1.000 et 2000 Fcfa par personne.
Par contre Bengaly Kondé soutient que le transport ne peut s’épanouir sans les jeunes « coxeurs ». Cet ancien chauffeur reconverti « coxeur », en raison d’une santé fragile, officie à la gare de Djicoroni Para. Il estime que les intermédiaires sont indispensables dans les gares même si des responsables de certaines compagnies pensent le contraire.
En effet, le chef de gare routière de Sogoniko, Siaka Sangaré, représentant le Syndicat national des transporteurs routiers urbain interurbain du Mali (SYNTRUI-Mali) déplore les conditions de travail de ces jeunes facilitateurs et la manière dont ils guident les voyageurs. Il en existe de toutes les nationalités. «C’est regrettable de les voir mentir aux voyageurs», souligne le syndicaliste.
« Nous avons tenté d’assainir le milieu en mettant en place une structuration, soutenue à l’époque par un projet américain en collaboration avec d’autres partenaires nationaux. Un numéro d’identification et une tenue avaient été donnés à chaque « coxeur ». Au-delà, on avait aussi organisé deux séances de formation à l’attention de 50 jeunes. Malheureusement, ce projet a été anéanti par les turbulences enregistrées dans notre pays. », dit Sangaré.
Oumar Kamaté, dit «Bob» est un jeune intermédiaire qui pratique cette activité depuis bientôt 10 ans à la même gare. «Etre intermédiaire est une question de choix. C’est un travail comme tout autre qui s’exerce dans l’informel, mais qui nous permet de vivre des revenus de nos efforts», d-it-il. Et de rappeler que la recette journalière d’un « coxeur » oscille entre 5 000 et 12 500 Fcfa.
Aïssata Soumounou, accompagnée de ses deux enfants, est en partance pour Kadiolo. Elle juge ces intermédiaires utiles. «Ils nous aident à prendre nos bagages gratuitement», dit la trentenaire. Les points de vue sur l’utilité des « coxeurs » continue. Les avis sont nettement tranchés sur ces « coxeurs ». Eux, continuent de faire régner la loi dans les gares routières.
AS/MD (AMAP)