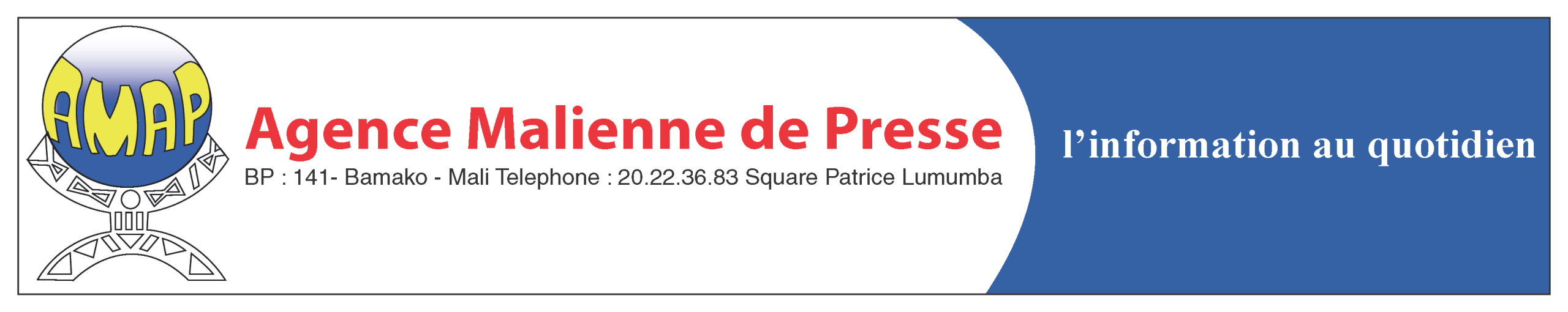Eléments de Barkhane en exercice (Archives)
Par Issa DEMBELE
Bamako, 18 fer (AMAP) Près d’une décennie d’engagement massif (5.100 soldats), des milliards d’euros engloutis, des dizaines de victimes…et, au bout, une fin dans un contexte de tension diplomatique entre la France et le Mali. Barkhane, la plus longue opération militaire extérieure française depuis 1962, se termine sur une mauvaise note qu’aucun des deux pays n’aurait souhaité
Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé hier solennellement la fin de l’opération Barkhane au Mali. Les soldats français vont donc devoir quitter notre sol, sans avoir réussi à enrayer la menace terroriste ni empêcher son extension aux pays voisins. Ils vont s’en aller presque sous les quolibets des Maliens, exaspérés par l’accumulation de drames, malgré la présence massive des forces étrangères chez nous.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a de l’électricité dans l’air en ce qui concerne les relations entre Bamako et Paris. Rien ne va plus entre les officiels français et maliens. Le ton paternaliste des premiers est jugé inacceptable par les seconds. Les liens se sont dégradés à tel point que l’on s’attendait à ces annonces faites mercredi à l’issue du mini-sommet qui a réuni à l’Élysée, le président français et certains dirigeants ouest-africains.
Désormais, il n’est plus question d’une simple ré-articulation du dispositif à l’effet d’associer d’autres pays européens, mais plutôt d’un désengagement total. La Task force Takuba, à peine opérationnelle, entamera aussi un «retrait coordonné». Le Canada et les États européens opérant au sein de cette force ayant estimé que «les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire». Mais, ils resteront dans la région, notamment au Niger et dans le Golfe de Guinée, pour poursuivre leur action contre le terrorisme. Les paramètres de cette action commune seront connus d’ici juin 2022.
Pour les Maliens, la fin de ces opérations signifie le début de quelque chose de nouveau, une prise en main de notre destin sur le plan sécuritaire. Un sentiment largement partagé et qui est à l’opposé de l’euphorie dans laquelle Serval avait été accueillie en 2013. Le temps des victoires a été court. «La guerre de libération du Mali est finie. Elle a été gagnée», affirmait Jean-Yves Le Drian le 20 mars 2014. Il avait ajouté que l’action des forces françaises avait permis au Mali de retrouver sa «souveraineté, que des élections aient lieu et qu’il y ait une fierté d’appartenance malienne qui se retrouve».
Neuf ans plus tard, les groupes terroristes ont étendu leur emprise. L’insécurité, d’abord concentrée au nord, a glissé vers le centre et s’est étendue vers les Régions de Koutiala et de Sikasso. Des localités des Régions de Mopti et de Ségou, sont soumises à des blocus. L’autorité de l’État ne s’est pas toujours rétablie à Kidal. En l’état, peut-on le dire, un désengagement fait figure d’échec patent.
Réadaptation- Le cadre et les objectifs de l’intervention française ont évolué au fil des années. À Pau, en janvier 2020, la France et les cinq pays du G5 Sahel redéfinissaient les contours de leur partenariat. La «Coalition pour le Sahel» lancée à l’occasion, visait à faciliter les interactions entre les différents volets de l’action internationale venant en appui des pays du G5.
Les objectifs militaires fixés à Pau ont eu le mérite d’avoir donné du punch à la lutte commune contre l’ennemi. Et les résultats opérationnels ont été au rendez-vous avec des coups sévères portés à l’EIGS et à la coalition formant le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Ainsi, des grands noms du terrorisme ont été éliminés, comme l’Algérien Abdelmalek Droukdal, chef des opérations d’Aqmi, Bah ag Moussa, un haut responsable du GSIM et l’émir de l’EIGS Al Saharaoui. Sans compter les centaines de combattants neutralisés.
Une année après, l’heure était à l’évaluation du dispositif. Cet exercice, qui a réuni le 15 février 2021 les chefs d’État dans la capitale tchadienne, a abouti à des conclusions fortes. Mais toujours est-il que les progrès n’ont pu combler les attentes. Ainsi, le ressentiment anti-français a persisté. Ce même ressentiment que le sommet de la «clarification» de Pau était censé dissiper. Cette situation qui agaçait déjà Paris s’était invitée dans les débats à N’Djamena, où les chefs d’État ont dû encore réaffirmer leur volonté de poursuivre le partenariat.
Côté malien, les autorités ont toujours reconnu l’intérêt du soutien de la France. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a affirmé dans une interview accordée à L’Essor qu’il n’y a «aucun doute possible, ces forces étrangères sont des alliés importants… Nous devrions nous convaincre que nous ne gagnerons pas cette guerre en nous trompant d’ennemi et en faisant le jeu des hordes terroristes».
Sauf que les autorités maliennes n’ont guère apprécié de ne pas avoir été associées à la prise des décisions concernant le réaménagement de l’opération Barkhane. En juin 2021, Emmanuel Macron a pris l’initiative unilatérale d’interrompre les opérations militaires communes (Barkhane-FAMa) qui n’ont repris qu’en juillet. Ensuite, il a annoncé la fin de l’opération Barkhane, avant d’expliciter son propos lors du sommet virtuel du G5 Sahel, le 9 juillet 2021. Étaient alors annoncées la réduction progressive des effectifs de Barkhane ainsi que la fermeture des bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou d’ici à 2022. Pendant ce temps, la France devait travailler à européaniser la lutte au Sahel pour ne plus endosser seule les efforts multiples.
Les autorités de la Transition ont vu dans ces décisions unilatérales un «abandon en plein vol» et ont, par conséquent, décidé d’explorer d’autres horizons pour trouver des partenaires pouvant aider à la sécurisation des populations et leurs biens. Concomitamment, d’importants efforts financiers sont consentis pour équiper les FAMa qui, indéniablement, montent en gamme. Pour certains analystes, les récents agissements des terroristes contre les populations sont l’expression d’une profonde lassitude, voire d’un découragement qui serait enfin le début de leur déclin que les FAMa recherchent à coups de traques et de frappes.
Le départ de la force Barkhane ne manque pas de susciter des interrogations quant à l’avenir de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Nul doute que nos autorités vont s’activer pour briser l’isolement que la France serait tentée d’organiser contre nous. Le Mali peut compter sur son puissant et nouvel allié, la Russie qui n’a jamais caché sa volonté de reprendre pied en Afrique, quitte à bousculer l’ancienne puissance coloniale dans son pré carré. Après la Centrafrique, le Mali est le deuxième pays où le bras de fer entre Français et Russes tourne en faveur des deuxièmes.
Aussi, le départ des forces étrangères, l’une des exigences de longue date des groupes extrémistes, pourrait-elle favoriser l’ouverture d’un dialogue entre les Maliens ? L’avenir nous le dira.
ID (AMAP)